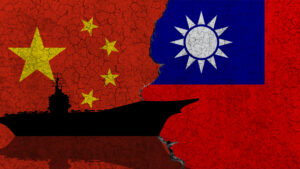Le déclin irréversible de l’industrie pétrolière américaine
Un puit de pétrole au Texas. – © DR
Le boom de l’industrie du schiste a longtemps entretenu l’espoir que les Etats-Unis puissent acquérir une nouvelle indépendance énergétique. Mais en réalité, le rêve de domination des Etats-Unis dans ce domaine a toujours été une illusion. La pandémie de coronavirus, en accélérant un processus de déclin déjà amorcé plusieurs années auparavant, a mis en lumière à quel point ce rêve reposait sur des sables mouvants.
En avril 2020, le monde a traversé l’une des pires crises pétrolières de son histoire. La demande mondiale de pétrole, habituellement inélastique (elle varie de 1 à 3% par an), a diminué soudainement de 30 millions de barils par jour. Le prix du Brent a logiquement suivi, chutant à 30 $/baril. Ceci n’a pas été sans conséquences pour l’industrie américaine du schiste, qui a besoin d’un baril autour de 50 $ en moyenne pour survivre. Withing Petroleum, un temps l’un des plus gros producteurs de schiste de Bakken, gisement du Montana et du Dakota du Nord, a rapidement fait banqueroute. Au Texas, des dizaines de milliers de personnes ont été licenciées dans les entreprises exploitant les gisements du bassin permien et d’autres champs pétro-gaziers de l’Etat, d’où provient 43% de la production de pétrole indigène. Au total, plus de 100 producteurs (sur les quelque 6000 opérant aux Etats-Unis) ont déposé le bilan en 2020.
Un modèle à bout de souffle
Depuis janvier 2021, les cours mondiaux sont remontés et les sociétés pétrolières ont repris quelques couleurs. Selon plusieurs spécialistes, cependant, ce regain est conjoncturel et ne peut occulter les failles inhérentes à un secteur sous perfusion depuis de nombreuses années. Derrière la croissance phénoménale de la production états-unienne de pétrole et gaz de schiste ces quinze dernières années se cache en effet une réalité moins reluisante. Depuis 2010, «l’industrie américaine du schiste a enregistré des flux de trésorerie négatifs de 300 milliards de dollars et déprécié plus de 450 milliards de dollars de capital investi», indique Deloitte dans un rapport publié récemment. En outre, selon le cabinet Haynes and Boone, plus de 500 producteurs de pétrole ou de gaz nord-américains ont fait faillite depuis 2015.
Comme l’a bien expliqué la journaliste Bethany McLean dans le New York Times: «L’indépendance énergétique de l’Amérique a été construite sur une industrie dépendante des investisseurs pour continuer à financer ses forages. Les investisseurs sont disposés à s’impliquer tant que les prix du pétrole, qui ne sont pas sous le contrôle des Etats-Unis, sont élevés – et lorsqu’ils pensent qu’un jour, les bénéfices se matérialiseront. Même avant la crise du coronavirus, le robinet se tarissait. Maintenant, il a été fermé.»
Depuis 2018, il est vrai, les Etats-Unis sont redevenus le premier producteur mondial de pétrole. Mais ce nouveau leadership n’a jamais permis à Washington d’inonder le marché de son pétrole de schiste, comme certains l’avaient prédit. Et cela ne sera certainement jamais le cas. «Désormais, il devrait être parfaitement clair que le modèle commercial du pétrole de schiste ne fonctionne pas – même pour les meilleures entreprises du secteur», a déclaré la société d’investissement SailingStone Capital Partners dans une note publiée en mars 2020.
La bulle du schiste
Sur les marchés américains, une bulle financière s’est donc constituée autour de l’industrie de schiste, alimentée par l’espoir que de nouvelles technologies puissent permettre aux entreprises du secteur de réduire leurs coûts pour forer toujours plus profondément et ouvrir rapidement de nouveaux puits de pétrole – en dépit du désastre écologique que ces activités engendrent. Mais cette stratégie semble vouée à l’échec.
Premièrement, si les puits sont à une distance rapprochée les uns des autres, ils interfèrent entre eux, ce qui a pour conséquences de diminuer la quantité de pétrole disponible, non de l’augmenter. Deuxièmement, comme le relève le géologue David Hughes, qui a travaillé 32 ans pour le Geological Survey of Canada: «Le déclin naturel de la plupart des gisements de schiste est de 25 à 40% chaque année». Et pour chaque puits individuel, la baisse est encore plus sévère, avec un déclin de production de 75 à 90% sur les trois premières années d’exploitation.
Prévisions optimistes de l’EIA
Depuis 2013, David Hughes pointe également du doigt un autre problème, rarement mentionné par les spécialistes européens. Le géologue a analysé tous les principaux champs pétro-gaziers de schiste américains. Il en a conclu que les prévisions annuelles (jusqu’en 2050) de l’Agence d’information sur l’énergie (EIA) du gouvernement américain sont «extrêmement optimistes». Et qu’il est donc «hautement improbable qu’elles se matérialisent» – même en situation où le marché dispose d’un baril à 50 $ ou plus.
Selon David Hughes, le meilleur scénario pour atteindre les prévisions du cas de référence de l’EIA nécessiterait l’ouverture de 1 451 771 nouveaux puits (onshore et/ou offshore) d’ici 2050, ce qui représenterait une dépense totale de 9500 milliards de dollars. Une estimation de 16% supérieure à celle proposée par l’agence américaine, selon les calculs du géologue. «Ceci aurait en outre pour conséquence d’épuiser totalement l’entier des ressources prouvées et non prouvées de pétrole et gaz de schiste des États-Unis d’ici 2050», précise David Hughes.
Un sursis temporaire
La conclusion du dernier rapport du géologue canadien mérite d’être citée in extenso: «En supposant que les estimations de l’EIA concernant les réserves prouvées et non prouvées soient correctes, l’épuisement de toutes les ressources de pétrole léger des Etats-Unis d’ici 2050 devrait être hautement préoccupant pour la planification de la sécurité énergétique à long terme du pays. En outre, étant donné le caractère extrêmement optimiste de la plupart des prévisions de l’EIA, il n’est nullement assuré qu’une telle quantité de pétrole et de gaz puisse être produite. Supposer, par conséquent, que la production restera à des niveaux élevés après 2050 est un vœu pieux.»
Washington-Riyad, une dépendance tenace
Cette analyse de la situation énergétique intérieure des Etats-Unis permet de mettre en perspective les relations entre Washington et ses principaux fournisseurs étrangers de pétrole, à commencer par l’Arabie Saoudite. Il est vrai que les relations entre les Etats-Unis et la pétromonarchie ont évolué depuis la conclusion du pacte du Quincy, en 1945. Mais d’un point de vue énergétique et géostratégique, les deux Etats continueront d’avoir besoin l’un de l’autre à l’avenir, quelle que soit par ailleurs la nature des tensions pouvant naître entre eux, et les conséquences en termes d’image pour Washington de maintenir une alliance avec une monarchie clanique piétinant systématiquement les acquis les plus élémentaires en matière de droits de l’homme.
En 2020, les Etats-Unis ont importé quotidiennement sur leur territoire près de 5,9 millions de barils de pétrole brut (pour 3,2 millions exportés). Sur ce volume, quelque 500 000 barils provenaient d’Arabie Saoudite (statistiques de l’EIA). «L’idée selon laquelle il n’y aurait plus d’importations américaines de pétrole en provenance de cette région, est donc également une erreur. Mais elle a l’avantage de venir en appui de la thèse (politique) du désengagement américain du Moyen-Orient!», souligne Gérard Vespierre, président de Strategic Conseils. Au vu de l’état de la production pétrolière aux Etats-Unis, parions que cette situation n’est pas près de s’inverser.
De plus, Washington a toujours besoin de l’appui saoudien au Moyen-Orient pour des raisons géopolitiques (en lien notamment à l’Iran). Sans compter l’appétit à plusieurs dizaines de milliards de dollars de Riyad et des Emirats arabes unis pour l’armement américain. Et l’influence d’un très puissant lobby pro-saoudien dans les coulisses de la Maison-Blanche.
À lire aussi