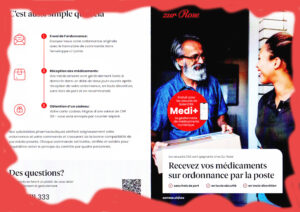Des substances psychédéliques pour traiter la dépression

Parmi les champignons hallucinogènes, il y a notamment le psilocybe. – © DR
Olivier Bosch travaille depuis 20 ans avec des substances psychotropes. En 2010, il a mis en place un projet de recherche sur le GHB, ou ecstasy liquide, sur lequel il travaille toujours. Il explique que le GHB agit par l’intermédiaire du principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau: lorsqu’elle est consommée à faible dose pendant la journée, cette substance a un effet stimulant sur l’humeur, l’euphorie et la libido, ainsi qu’une influence positive sur les interactions sociales. C’est pourquoi le GHB est intéressant pour la recherche sur la dépression. Par rapport aux substances sédatives comme les benzodiazépines (pour traiter les insomnies), le GHB favorise le sommeil profond. Une étude est parrainée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique pour étudier l’amélioration de la mémoire grâce à cette substance, laquelle pourrait profiter aux patients qui souffrent à la fois d’un sommeil profond perturbé et d’un trouble cognitif. C’est particulièrement vrai pour les patients souffrant de dépression et de démence.
Restons prudent, il n’y a pas suffisamment d’études
Aujourd’hui, il existe des études sur la MDMA (molécule chimique psychoactive), la psilocybine (molécule psychoactive provenant des champignons) et le LSD (molécule semi-synthétique hallucinogène) qui montrent des effets positifs sur la dépendance, la dépression et le syndrome de stress post-traumatique. Une étude publiée dans Le Lancet en 2016 a apporté un soutien préliminaire à l’innocuité et à l’efficacité de la psilocybine dans le traitement de la dépression résistante au traitement et incite à réaliser d’autres essais, avec des plans plus rigoureux, pour mieux examiner le potentiel thérapeutique de cette approche. Mais jusqu’à présent, il ne s’’agit que de petites études portant sur dix à soixante personnes, en partie sans groupe placebo. Pour en savoir plus, il faut des études de plus grande envergure ayant une bonne structure scientifique, c’est-à-dire un grand nombre de cas et comprenant un groupe placebo et un groupe verum (vrai). Donc une «étude randomisée en double aveugle», ce qui signifie que durant l’étude sur un médicament, ni le patient ni le prescripteur ne savent si le patient utilise le médicament actif ou le placebo. Le rôle d’un tel protocole est de réduire au mieux l’influence sur la ou les variables mesurées que pourrait avoir la connaissance d’une information à la fois sur le patient (premier «aveugle») et sur le médecin (deuxième «aveugle»). Mais dans le cas des substance hallucinogènes, une étude randomisée en double aveugle est difficile à mettre en place car c’est l’expérience qui est centrale et non les variables.
Les effets de la psilocybine sur le cerveau
La psilocybine peut augmenter la flexibilité du cerveau et le rendre plus réceptif aux nouvelles idées et aux nouveaux schémas de pensée. Des études antérieures suggèrent que cette molécule s’adresse à la partie du cerveau qui gère l’état de repos et qui s’active lorsque les gens s’adonnent à l’autoréflexion et laissent leur esprit vagabonder. Chez les patients souffrant de troubles anxieux et de dépression, ce réseau cérébrale responsable de repos est hyperactif, ce qui est associé à la rumination, à l’inquiétude et à une pensée inflexible. La psilocybine semble modifier de façon aiguë l’activité de cette partie du cerveau.
Traitement sous surveillance
Les substances sont utilisées dans un cadre contrôlé en présence d’un psychiatre qui prépare et suit l’expérience avec le patient de manière thérapeutique. Ainsi, l’expansion de la conscience provoquée par les psychédéliques peut apparemment briser le cercle de pensées négatives typique de la dépression. Le voyage contrôlé peut déclencher une amélioration durable, comme l’a montré une petite étude menée auprès de patients qui avaient développé des symptômes dépressifs à la suite d’un cancer.
Cependant, nous n’en sommes pas encore au stade où cette substance peut être décrite sans équivoque comme efficace et peut être facturée aux compagnies d’assurance maladie en toute bonne conscience. Les méthodes de thérapie par les psychédéliques doivent encore être établies et faire l’objet d’études approfondies.
En avant dans la recherche!
Dans une Suisse où 40 à 60 % des patients traités par des médecins généralistes reçoivent des psychotropes (substance chimique qui agit principalement sur l’état du système nerveux central en y modifiant certains processus biochimiques et physiologiques cérébraux, sans préjuger de sa capacité à induire des phénomènes de dépendance, ni de son éventuelle toxicité) et que ce nombre a fortement augmenté ces dernières années, il est peut-être temps de trouver d’autres méthodes moins nocifs et moins chimiques pour aider ces malades.
La thérapie psycholytique en bref
La thérapie psycholytique a été développée depuis les années 1950. «Psycholyse» signifie «relâchement/solution de l’âme». Les drogues utilisées à des fins thérapeutiques comprennent les entactogènes comme la MDMA et/ou les hallucinogènes comme le LSD ou la psilocybine (voir les définitions ci-dessous). En Suisse, les thérapies psycholytiques sont légales, mais nécessitent une autorisation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Les conditions suivantes doivent être remplies
- Conformément aux alinéas 1 et 3 de la loi sur les stupéfiants, l’OFSP peut accorder des autorisations exceptionnelles pour l’usage expérimental et médical limité des dits stupéfiants si aucun accord international n’est en conflit.
- Cette disposition ne s’applique qu’aux personnes résidant en Suisse.
- La thérapie doit être demandée et justifiée en détail par un médecin travaillant en Suisse.
- Il doit s’agir d’un trouble mental important, pour le traitement duquel il est prouvé que des tentatives ont déjà été faites en médecine conventionnelle sans succès suffisant.
- La thérapie psycholytique s’accompagne toujours de plusieurs mois de psychothérapie conventionnelle préparatoire et de suivi. Cela nécessite une certaine proximité du domicile du patient et une certaine mobilité, car le patient doit être en mesure de se rendre régulièrement aux séances de psychothérapie en personne.
De plus amples informations sont disponibles auprès de la Société médicale suisse pour la thérapie psycholytique SÄPT.
Lire l’article original
À lire aussi