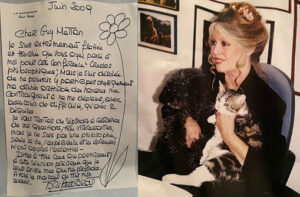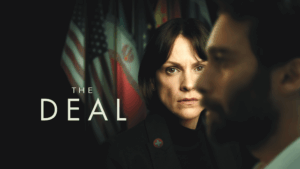Les comédies françaises sont nulles, même le public les boude
«On peut tromper mille fois mille personnes, non, on peut tromper une fois mille personnes, mais on ne peut pas tromper mille fois mille personnes. Non, on peut tromper une fois mille personnes mais on peut pas tromper mille fois une personne. Non… » Cette réplique de «La Cité de la Peur», comédie des Nuls devenue culte, pourrait s’appliquer au sort réservé aux comédies françaises en ce début d’année. Hormis «Raid Dingue» de Dany Boon et «Alibi-com» de Philippe Lacheau («Babysitting»), elles ont perdu la martingale qui les plaçait toujours en tête du box-office.
Depuis janvier, elles accumulent les contre-performances. «Gangsterdam», avec Kev Adams, star du box-office en 2015, est un flop malgré son buzz sur «le viol cool». «A bras ouverts» qui reprend en pire les ficelles de «Qu’est-ce que j’ai fait au Bon Dieu?» peine à faire son million d’entrées alors que son aîné avait engrangé 12 fois plus. Même revers pour «Boule et Bill 2», «Telle mère telle fille», «Jour J» ou «Sous le même toit». Et ce n’est pas avec «Les ex», comédie pour bobos vieillots, «Comment j’ai rencontré mon père», une mièvrerie à la sauce hollandaise, ou l’affligeant «Mon poussin», autant de films sortis en juin, que la tendance se renversera.
Seule «Marie-Francine» semble échapper à la malédiction. Même si ce n’est pas son meilleur film, Valérie Lemercier persiste dans une certaine idée de l’artisanat, soignant l’écriture et le jeu d’acteur.
Pour justifier ce Waterloo du rire made in France, les professionnels citent une campagne présidentielle qui a passionné les Français, la concurrence avec les blockbusters américains mais aussi l’attraction opérée par les plate-formes internet, payantes ou gratuites. Et si c’était plus simple? Et si le public, à l’image des électeurs qui ont fait savoir qu’ils souhaitaient rompre avec le vieux monde, n’en pouvait plus de ces comédies mal écrites, mal jouées, à la mise en scène brouillonne, aux dialogues indigents, aux recettes éculées, et dont le meilleur est souvent dans leurs bandes-annonces. Comment en est-on arrivé là? Pourquoi un tel désamour? Les causes sont multiples, et tiennent en premier lieu à système de financement du cinéma en surchauffe.
Subvention et absence de risques
Avec ses 280 films par an, dont la grande majorité ne sont pas rentables, la France détient le record de films par habitant et du coût moyen de production: 4,4 millions d’euros, alors qu’un film indépendant américain tourne autour de 3 millions d’euros. Pourquoi une telle inflation? Parce que la majorité des productions sont prépayées par une série de subventions, d’aides, de taxes, d’obligations et de redistributions, sur la base d’un principe qui a longtemps porté ses fruits: ceux qui exploitent le cinéma le financent. Ce qui a permis à la cinématographie hexagonale d’échapper à la loi du marché – la fameuse exception culturelle – ce qui ne vas pas sans effets pervers.
Depuis quelques années, le cinéma s’est installé dans un système en circuit fermé, où le producteur ne prend quasiment plus de risques et où le spectateur, même s’il ne va voir que des blockbusters américains, le fait vivre via la taxe prélevée sur son billet d’entrée. Ce déséquilibre en faveur de l’offre condamne ainsi les films les plus fragiles à une quasi-invisibilité tandis que les films à grands budgets, qui accaparent une grande partie des salles, jouissent d’aide automatique. Beaucoup dénoncent aujourd’hui un système où les bénéfices sont privatisés, tandis que les pertes sont mutualisées.
Une télévision toute puissante
L’autre «faiblesse» du cinéma français est sa dépendance à la télévision, producteur majoritaire. Cette dépendance a deux conséquences: des contraintes dans le choix des sujets traités et l’obligation d’avoir recours à des «bankables» pour assurer leur audience. On se souvient de la polémique lancée en 2012 par le producteur et distributeur Vincent Maraval* qui dénonçait les cachets délirants de certains acteurs français, notamment Dany Boon qui reste néanmoins le plus rentable. D’où la concentration des rôles dans les mains d’une poignée de comédiens, toujours les mêmes: Chabat, Omar Sy, Benoit Poolvoerde, Kev Adams, Djamel Debouze, Gad Elmaleh, Michaël Youn, Christian Clavier, etc. Sans sous-estimer leur talent, à raison de deux comédies par an, souvent dans les mêmes rôles similaires, on a envie de crier «Dégagez!».
Milieu incestueux
Canal+ a été, et reste, le plus grand argentier du cinéma français. Et si la chaîne cryptée a permis à la France de conserver sa vitalité cinématographique, elle n’est plus ce qu’elle était. Non seulement elle a perdu son esprit mais a réduit considérablement son budget cinéma, souvent au profit de séries bien meilleures. Avant d’en arriver là, elle a fait naître plusieurs générations de comiques qui ont forgé l’identité de la chaîne et que Canal a promu, dans un esprit de synergie, en princes de la comédie française. La boucle est bouclée: la télévision qui a besoin de cinéma, nourrit le cinéma avec de la télévision. M6 fait pareil. Tout ce petit monde reste dans l’entre-soi, chacun s’octroyant tour à tour des casquettes de scénaristes, producteurs, acteurs et réalisateurs. On le sait, la consanguinité finit par affaiblir l’espèce, soit parce qu’elle multiplie le même, soit parce qu’elle empêche d’autres talents d’émerger.
La logique du like
Un youtubeur émerge, une miss Météo fait le buzz, un comique de stand-up a sa petite heure de gloire, et voilà qu’aussitôt on lui donne les moyens de faire son long métrage. Pour surfer sur la vague de leur popularité, on monte en vitesse un projet comme si faire des gags vous élevait au rang de scénariste et avoir un style vous garantissait d’être bon acteur. On gave avant de nourrir. C’est exactement ce que dit la Christine Gozlan, productrice de Coline Serreau ou Jacques Doillon: «Les responsables ne sont pas les acteurs, ce sont les producteurs – et j’en fais partie – qui d’une part budgètent trop haut [les blockbusters français] afin de lancer dans l’urgence une affaire dans les empreintes encore fraîches d’une première réussie, et qui d’autre part continuent de croire que le public va se contenter de revoir les mêmes acteurs dans une histoire insipide».
Un déficit d’écriture
Cette obligation à aller vite néglige la première étape d’un film, le scénario. L’écriture demande du temps, surtout dans la mécanique très précise du rire. Il manque aujourd’hui des scénaristes capables de mener une histoire dans la durée et pas seulement quelques rigolos qui enchaînent les vannes ou tirent le même gag sur 1h30. Mais l’écriture souffre d’un autre mal: le formatage. Pour Pascal Thomas, réalisateur de «Les Maris, les femmes et les amants», la faiblesse des scénarios vient de ce que trop de gens interviennent sur un script: «Le problème des multiples commissions et financements des films, c’est que tout ce qui gratte dans une histoire, est lissé, policé. Depuis quelques années déjà, une certaine bien-pensance s’est emparée de ce qui reste de créativité dans le cinéma français». Pour Eric Judor, dont la dernière comédie «Problemos» est un échec cuisant alors qu’elle a au moins le mérite d’être drôle et cruelle, le mal vient de ce que les scénarios sont toujours les mêmes: «Des histoires simplistes qui traitent de la lutte des classes. Les pauvres contre les riches (…) Il y a un truc redondant, ronflant et fainéant dans la comédie en France».
Mutliplier plutôt qu’inventer
Depuis le succès de la saga des «Astérix», la BD est une manne pour la comédie française. On ne compte plus ses adaptations pour le grand écran, du «Marsupilami» à «Boule et Bill», des «Profs» à «L’élève Ducobu» en passant par «Le Petit Nicolas». Pourquoi écrire des histoires originales quand ce qui existe déjà rassure les financiers? Autre maladie des comédies françaises, qui s’inspirent du modèle américain ou de la saga des «Gendarmes», les suites ont tendance à devenir systématiques. Mais si les producteurs ont de la suite dans les idées, il manque souvent d’idées dans les suites. Sans compter le risque du film de trop qui fera oublier ses réjouissants précédents. «Les Bronzés 3» et le dernier épisode des «Visiteurs» en sont les plus affligeants exemples.
* Vincent Maraval, sa tribune dans le Monde.
À lire aussi