Prix Nobel d’économie: pourquoi certaines nations sont-elles riches et d’autres pauvres?
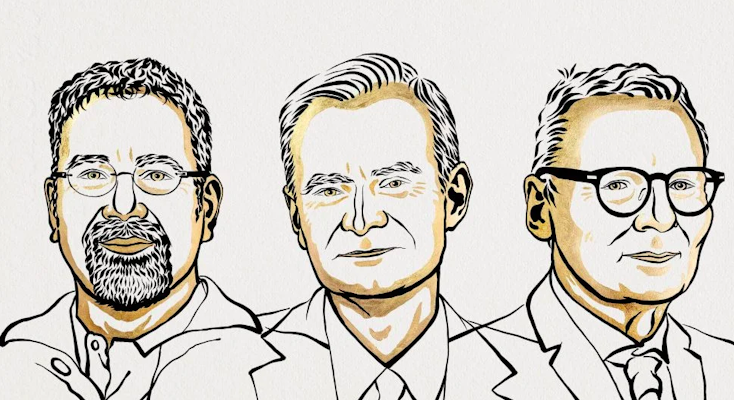
Portraits de Daron Acemoglu, Simon Johnson et James A. Robinson, qui partagent le prix Nobel d’économie 2024 pour leurs travaux sur la manière dont les institutions se forment et affectent la prospérité. Niklas Elmehed/Nobel Prize Outreach
Thierry Verdier, École des Ponts ParisTech (ENPC)
En 2022, selon la Banque Mondiale, le revenu par habitant du Danemark est de 74 000 dollars (ramené au pouvoir d’achat) alors que celui de la Sierra Leone s’établit à 1 900 dollars. Comment expliquer de telles différences de revenu entre les nations ? Comment aussi expliquer que même lorsque les pays les plus pauvres tendent à s’enrichir, ils ne rattrapent pas les plus prospères ? C’est sur ces questions que portent les travaux des lauréats du prix Nobel d’économie (plus exactement le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel) de cette année, Daron Acemoglu, Simon Johnson et James A. Robinson. Leurs apports mettent en lumière de façon empirique et théorique qu’une explication importante de ces questions est liée à la relation centrale entre institutions (droits de propriété, système juridique, systèmes politiques, gouvernance publique) et prospérité.
Le rôle de la colonisation, un facteur clé
Une des principales contributions des lauréats a été de considérer l’expérience historique de la colonisation, et plus précisément la nature des systèmes politiques et économiques que les colonisateurs européens ont introduits, ou ont choisi de conserver, à partir du XVIe siècle dans le monde colonisé. Ils observent que ce type d’institutions dépend du nombre de colons européens établis dans la colonie.
Lorsque l’environnement a été plus hostile, soit du fait d’une population indigène plus dense et résistante à l’envahisseur, soit du fait de la prévalence de maladies mortelles et dangereuses, les colonisateurs ont été de fait moins nombreux. Ils ont alors mis en place des institutions extractives pour exploiter les masses au profit d’une élite locale, instituant des droits politiques extrêmement limités. Ceci a été néfaste à la croissance à long terme.
En revanche, les colonies comptant de nombreux colonisateurs – les colonies dites de peuplement – ont développé des institutions économiques inclusives qui ont incité les colons à travailler et à investir dans leur nouvelle patrie. Cela a conduit en retour à des revendications de droits politiques qui leur ont donné une part des bénéfices. Ces institutions établissant les libertés économiques fondamentales et l’État de droit ont été bénéfiques au développement économique.
En utilisant, entre autres, les chiffres de mortalité des colonisateurs, les lauréats du prix Nobel ont ainsi mis en évidence le fait statistique suivant corroborant cet argument : plus élevée a été la mortalité parmi les colonisateurs, plus faible est aujourd’hui le revenu par habitant, et plus grandes sont la pauvreté, la corruption et l’absence d’État de droit.
Comment changer de systèmes quand les intérêts diffèrent
Les lauréats du prix Nobel ont également développé un cadre théorique innovant qui explique pourquoi certaines sociétés se retrouvent coincées dans le piège d’institutions extractives, et comment il est parfois possible de se libérer de ses institutions héritées du passé pour établir la démocratie et l’État de droit.
L’explication des lauréats se concentre sur les conflits autour du pouvoir politique et le problème de crédibilité entre l’élite dirigeante et la population. Tant que le système politique profitera aux élites, la population ne pourra pas croire que les promesses d’un système économique réformé seront tenues. À l’inverse, un nouveau système politique, donnant à la population l’opportunité de remplacer les dirigeants qui ne tiennent pas leurs promesses, permettrait de réformer le système économique.
Cependant, les élites dirigeantes ne croient pas que la population les compensera pour la perte d’avantages économiques une fois le nouveau système en place. Ce problème dit « d’engagement » est difficile à surmonter, et il explique pourquoi certaines nations restent piégées dans des structures d’institutions extractives, avec une pauvreté de masse et une grande inégalité entre élites dirigeantes et autres membres de la société.
La démocratie par manque de confiance ?
De façon intéressante, cette même incapacité à faire des promesses crédibles peut aussi expliquer pourquoi des transitions vers la démocratie se produisent parfois. En effet, même si la population d’une nation non démocratique manque de pouvoir politique formel, elle dispose d’une arme redoutée par les élites dirigeantes : son nombre. Une mobilisation des masses peut en effet se matérialiser en menace révolutionnaire pour les élites.
Ces élites sont alors confrontées au dilemme suivant : elle préférerait rester au pouvoir et tenter simplement d’apaiser les masses en promettant des réformes économiques. Mais une telle promesse n’est pas crédible car les masses savent que les élites peuvent rapidement revenir à l’ancien système une fois la situation calmée. Dans ce cas, la seule option pour l’élite pourrait alors être de céder le pouvoir et d’introduire la démocratie. Ceci permettrait la mise en place de politiques économiques plus favorable à la croissance et à la redistribution vers les masses, tout en évitant les conséquences plus coûteuses de la violence et la révolution.![]()
Thierry Verdier, Professeur d’économie, chaire associée à l’École d’économie de Paris, École des Ponts ParisTech (ENPC)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
À lire aussi
















