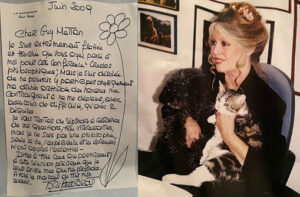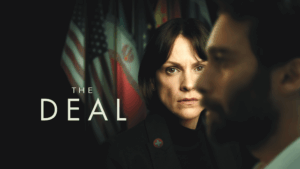Les voies sinueuses de la consolation
© Sister Distribution
Ne surtout pas hésiter à s’embarquer pour les trois heures de ce voyage en voiture! Franchement, on ne voit pas qui pourrait le regretter, ne pas sortir de Drive My Car profondément remué, en tous les cas enrichi. Le présent texte pourrait s’arrêter là, pour ne rien déflorer. Mais on attend plus d’arguments d’une critique, surtout d’un film venu de si loin. Alors sachez encore que malgré le rôle central tenu par ledit véhicule (une Saab rouge), il ne s’agit nullement d’un road movie. Juste d’un film à base de relations humaines, d’amour et de deuil, de paroles et de silences, de mise en scène et de quête de vérité. Un film qui a du souffle même s’il provient d’un texte court, un de ces récits à double détente comme Haruki Murakami – écrivain peut-être trop populaire pour se voir un jour «nobelisé» – sait en imaginer. Mais cette nouvelle a surtout eu la chance d’inspirer un vrai cinéaste, capable de la densifier par les moyens d’un art qui, pour le coup, redevient magique. Et ceci sans le moindre effet spécial, à moins d’y inclure le langage des signes.
Tout commence à Tokyo, dans un Japon moderne et aseptisé, avec une femme à sa fenêtre d’un grand immeuble, qui raconte une étrange histoire à l’homme qu’elle rejoint bientôt au lit. Il s’agit d’un couple marié – une scénariste de télévision et un acteur de théâtre – plus dans leur prime jeunesse et pour qui l’amour physique joue un rôle apparemment primordial de déclencheur d’imaginaire. Mais cette belle façade de bonheur lisse ne tarde pas à se craqueler à l’occasion de la découverte d’une infidélité, de la révélation d’un deuil passé, puis d’un événement dramatique. Après quarante minutes survient soudain le titre, suivi du générique, et on comprend qu’il ne s’agissait là que d’un prélude! Que pourra donc ajouter le «vrai film» à ce récit qui paraît déjà clos, d’une finalité irrévocable? Un nouvel éclairage, bien sûr. Mais Dieu sait quels détours il va falloir pour y arriver!
Les détours de la compréhension
Deux ans plus tard, on retrouve l’homme, Yuyuke Kafuku, qui accepte la proposition du centre culturel de Hiroshima pour mettre en scène l’Oncle Vania de Tchékhov. Il veut tenter une version multilingue et engage pour cela des acteurs asiatiques issus de différents pays. Parmi les candidats, il a la surprise de reconnaître le jeune amant de sa femme, Takatsuki, auquel il finit par confier le rôle-titre, a priori hors de sa portée. Par ailleurs, pour des raisons d’assurances, Kafuku se voit assigner une jeune chauffeure, Misaki Watari, pour ses trajets. Un détail sans importantce? Sauf que cela compromet son travail de préparation solitaire: il avait en effet l’habitude de répéter le texte au moyen d’une cassette enregistrée par son épouse.
Le film s’installe alors dans une suite de répétitions théâtrales, de trajets en voiture entre la résidence sur une île voisine et le lieu de travail, et de soirées où l’on apprend à mieux se connaître. A quel jeu joue donc Kafuku en testant Takatsuki, et le sait-il lui-même? Ne court-il pas à l’échec en poussant son expérimentation jusqu’à engager une actrice coréenne muette qui communique en langage des signes? Et que peuvent donc bien échanger ce «bobo» quadragénaire et cette fille du peuple inculte qui l’emmène visiter l’usine d’incinération d’Hiroshima? Originaire de l’île de Hokkaïdo, au nord du Japon, elle aussi cache en fait une profonde fêlure qui va peut-être les aider à se comprendre…
Murakami comme Tchékhov
Cinéaste indépendant de 42 ans dont c’est déjà là le neuvième long-métrage de fiction, féru de John Cassavetes et de Jacques Rivette (entre autres), Ryusuke Hamaguchi s’appuie sur un travail très poussé avec les acteurs, un choix précis des décors et une certaine dérive temporelle. De sorte que ce sont autant ces choix de mise en scène que le formidable sujet de Murakami qui donnent au film ce souffle inhabituel, qui ne fait que gagner en puissance. Un crescendo d’autant plus étonnant qu’il va à l’encontre du principe du vieux mélo- ou psychodrame. On peut ainsi avoir été gêné par la frontalité sexuelle de l’introduction, pas forcément acquis à l’expérience artistique où tout ne paraît que distance insurmontable entre les êtres, le final n’en deviendra que plus irrésistible par la profondeur du lien inédit qui s’instaure entre Kafuku et Masaki.
Un peu comme le Coréen Lee Chang-dong dans son mémorable Burning (2018), Hamaguchi a su s’appuyer sur la prose neutre de Murakami pour déployer son propre style, qu’on avait déjà pu apprécier dans Asako I & 2 (variation sur Vertigo également révélée à Cannes en 2018). Mais cette fois, c’est clairement la mise en abyme et la référence à Tchékhov qui lui permettent de franchir un nouveau palier. Car c’est une chose que de viser l’empathie avec la souffrance d’autrui, de tisser des histoires de deuil et de désespoir, de jalousie et culpabilité. Mais c’en est encore une autre que de parvenir à en extraire une oeuvre capable de résonner aussi fortement chez tout un chacun. Et cela, l’auteur d’Oncle Vania, Les Trois soeurs et La Mouette savait le faire mieux que tout autre.
Lorsqu’on est soudain saisi par une image de désolation sous la neige, bouleversé par une actrice dont on ne comprend pas la langue, consolé devant des plans anodins qui ont pourtant valeur d’adieu, on se dit que quelque chose d’essentiel, du même ordre, a passé. De quoi méditer longuement, en espérant bientôt avoir l’ocasion de découvrir l’opus précédent du cinéaste, Wheel of Fortune and Fantasy, Grand Prix du Jury au dernier Festival de Berlin.
«Drive My Car», de Ryusuke Hamaguchi (Japon, 2021), avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada, Reika Kirishima, Park Yoo-rim, Jin Dae-yeon. 2h59
À lire aussi