Wokisme, les territoires perdus de la pensée

Manifestation Black Lives Matter à Londres, le 6 juin 2020. – © Socialist Appeal – Black Lives Matter – CC BY 2.0
En 2020, le musée archéologique de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, fit l’objet d’une plainte signée par 200 étudiants et professeurs au motif que ses plâtres étaient trop blancs. L’honorable université se voyait ainsi accusée de participer au racisme systémique de l’Occident moderne. Que croyez-vous qu’il advint? La réponse du département incriminé ne se fit point attendre: il s’engagea, après avoir reçu la pétition des offensés, à mener un plan d’action en 13 points contre l’absence honteuse de diversité dans la sculpture gréco-romaine. Les Monty Pythons n’auraient pas pu imaginer histoire plus grotesque, et pourtant, cette anecdote est bien réelle – une parmi tant d’autres, judicieusement choisie par Sylvie Perez.
La grande «chance» du wokisme, souligne l’essayiste, est «qu’on le prend à la légère; on en sous-estime le sérieux, faute d’en mesurer les implications et le potentiel révolutionnaire». Ce ridicule sidérant s’accompagne, par ailleurs, d’un caractère protéiforme qui le rend difficile à circonscrire. «Régulièrement, s’ouvrent de nouveaux fronts assortis de revendications auxquelles ont ne s’attendait pas tant elles heurtent le bon sens», précise encore Sylvie Perez. Lecteur, te voici prévenu: passé l’incrédulité, tu pénètres bel et bien sur un champ de bataille.
Le mot «woke» est né les années 30 aux Etat-Unis, dans le milieu des chanteurs de blues noirs. «To be awoken», devenu «woke», signifiait «être éveillé», rester vigilants face à la ségrégation raciale bien réelle de l’époque. A la fin du XXème et début du XXIème siècles, le mot est devenu un mode de pensée qui s’est non seulement propagé à une allure folle dans les universités américaines, mais a également traversé l’Atlantique pour gagner le Royaume-Uni et l’Europe.
Le «wokisme» (terme que ses partisans récusent) s’immisce dans toutes les sphères de la pensée et de la société pour devenir une nouvelle forme de terrorisme intellectuel. Ancré dans le politiquement correct le plus intransigeant, il veut dominer au nom de minorités qu’il prétend défendre (les femmes, les homosexuels, les trans, les groupes ethniques, etc.). En toute logique totalitaire, son but est de restreindre la liberté d’expression de ceux qui croient encore aux vertus du débat rationnel plutôt qu’au règne des affects infantilisants. On l’aura compris, le wokisme ne tolère pas d’opposant: tout contestataire est un ennemi à abattre dont on va sonder la conscience au motif que l’on ne se sent pas respecté. Ou quand le respect, devenu un succédané de la course à la victimisation, exécute le principe même de tolérance…
Sans jamais se départir d’un humour délicieusement deadpan typiquement britannique, Sylvie Perez répertorie de manière édifiante les procédés et les instruments utilisés par les militants wokes aux Etats-Unis, Royaune-Uni et en France pour prendre le pouvoir au sein des universités et des écoles, mais aussi la fonction publique, la santé, la politique, le sport, etc. La liste est longue, éloquente. Le climat est celui d’une terreur généralisée où des conférences sont frappées d’interdiction (cancelled), des intervenants menacés physiquement, des professeurs tenus de démissionner, des scientifiques harcelés, des lois instrumentalisées au profit de zones grises de restriction de la liberté d’expression et d’un encouragement à la délation. La langue elle-même est purgée par des rituels politico-linguistiques. Le «wokish», ce nouveau sabir, remise sans hésiter la biologie aux oubliettes en renommant l’anus «vagin universel» par souci d’inclusion des transgenres, bien entendu. Sans oublier les offres de consulting spécialisé dans la rééducation à la diversité, qui confond allègrement égalité et égalitarisme. Car le wokisme est un business florissant, avec ses experts autoproclamés, champions de la culpabilité pour tous et de la notion de «préjugés inconscients» pour chacun, qui savent habilement monnayer leurs interventions auprès des entreprises et des institutions de l’Etat, toutes fort soucieuses de montrer pattes blanches en termes de politiquement correct.
Pour autant, la démarche de Sylvie Perez ne se résume pas à dresser un état des lieux, certes désolant, de la lâcheté et du cynisme ordinaires face à ce totalitarisme des temps modernes. Son livre va plus loin en retraçant les initiatives les plus éclairantes de la résistance anglo-saxonne désormais à l’avant-garde d’une lutte qui devrait être celle de tous les défenseurs de la liberté d’expression. Certains de ces combattants prêts à monter sur le ring pour débattre là où les wokes ne pensent qu’à faire taire leurs opposants, sont devenus des super stars médiatiques à l’instar du docteur en psychologie Jordan Peterson, de l’explosive féministe Camille Paglia, ou bien de l’intellectuel polémiste Douglas Murray. Mais En finir avec le wokisme rend également justice aux initiatives d’individus moins flamboyants. Ceux-ci ont dû trouver des alliés, constituer eux-mêmes des coalitions de défense et de ripostes, élaborer des outils efficaces pour contre-carrer une machinerie de condamnation morale et sociale woke bien huilée. Sylvie Perez est allée à leur rencontre, les a interrogés. En prenant connaissance de leurs histoires, on mesure la solitude et le courage de ces résistants qui ont souvent risqué leur réputation, leur carrière, leur sécurité comme celle de leur famille – voire tout à la fois, en se jetant dans cette bataille sans pitié.
On referme En finir avec le wokisme avec à la fois un sentiment de frayeur face à l’ampleur des dégâts (intellectuels, sanitaires, politiques…) et d’admiration à l’égard de ceux qui ont refusé de se plier aux menaces de cette nouvelle forme d’inquisition. «L’ère post-woke est devant nous», annonce Sylvie Perez à la lumière de ce qui se passe outre-Atlantique et au Royaume-Uni, curieuse de ce que la France sera capable elle-aussi de répliquer pour défendre les fondements même de notre liberté de penser. Serons-nous à la hauteur de ce qu’enseigne l’histoire de la lutte contre l’obscurantisme? Cette histoire qui représente «un trésor pour toujours plutôt qu’une production d’apparat pour un auditoire du moment», écrivait Thucydide dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse. C’était au Vème siècle avant notre ère.
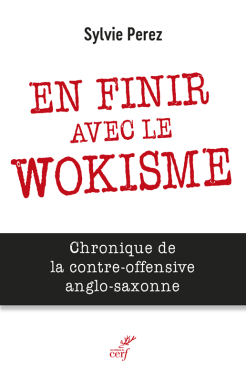
«En finir avec le wokisme», Sylvie Perez, Editions du Cerf, 366 pages.
À lire aussi












