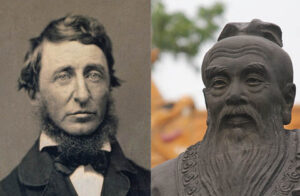Qui sont les Houthis, cette milice yéménite visée par les frappes américaines et britanniques?

Manifestation dans la capitale Sanaa, contrôlée par les houthis, le 12 janvier 2024, à la suite des frappes des forces américaines et britanniques, Le portrait est celui de Hussein al-Houthi, tué en 2004, qui a donné son nom au mouvement. Mohammed Huwais/AFP
Natasha Lindstaedt, University of Essex
Les dirigeants du groupe sont issus de la tribu Houthi, qui fait partie de la confédération Bakil, la plus grande des trois grandes confédérations tribales du Yémen avec les Hashid et les Madhaj. Alors que les États-Unis et le Royaume-Uni ont effectué une série de frappes militaires contre le groupe yéménite, après une série d’attaques menées par la milice contre des navires de la mer Rouge, voici quatre choses qu’il faut savoir au sujet des Houthis.
1. Pourquoi les Houthis se sont-ils formés ?
Pour comprendre la montée en puissance des Houthis, il convient tout d’abord de retracer l’histoire mouvementée du Yémen. Depuis sa création en 1990, le Yémen a peiné à édifier un État unifié et efficace, et a été en proie à la faiblesse de ses institutions et de son nationalisme, à l’insurrection et au sécessionnisme.
La région qui comprend aujourd’hui le Yémen a été divisée en deux territoires, le nord et le sud du XIXe siècle à 1990. Après l’effondrement de l’empire ottoman, le Yémen du Nord est devenu indépendant en 1918 tandis que le sud du Yémen est resté sous contrôle britannique jusqu’en 1967 avant de gagner son indépendance cette année-là sous le nom de République démocratique populaire du Yémen (Yémen du Sud), au régime marxiste et soutenu par l’URSS. Les deux Yémens ont ensuite été unifiés en 1990.
Les identités tribales restent fortes, en particulier dans le nord, et de nombreux groupes différents ont détenu le pouvoir dans l’histoire de la région. Les chiites zaydites se sont battus pendant des milliers d’années pour le contrôle du territoire que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Yémen, avec un certain succès. Aujourd’hui, sous l’égide des Houthis, ils contrôlent certaines parties du nord du Yémen.
Si nous avançons rapidement jusqu’à l’ère moderne, le Yémen a été confronté à des conflits constants et à la faillite de l’État. Le nord du pays était dirigé depuis 1978 par le dictateur Ali Abdullah Saleh, qui a ensuite pris la tête du Yémen nouvellement unifié en 1990. Les proches de Saleh contrôlaient alors des pans entiers de l’armée et de l’économie – et la corruption était un fléau extrêmement répandu.
Des tensions sont apparues parce que la grande majorité des ressources du Yémen alimentaient Sanaa, la capitale du Yémen du Nord, et en particulier le clan Sanhan de Saleh, membre de la fédération Hashid. Bien que le gouvernement central ait réussi à maintenir l’unité du pays (Saleh a notamment déclaré que gouverner le Yémen revenait à « danser sur la tête de serpents ») après la tentative de sécession du sud en 1994, de nombreux groupes ont exprimé des griefs à l’encontre du gouvernement dirigé par Saleh.
Les Houthis ont été parmi les principaux contestataires du gouvernement central du Yémen. En plus de subir des décennies de marginalisation politique, de négligence, d’exclusion économique et parfois de terreur de la part du gouvernement central, les Houthis étaient préoccupés par l’influence saoudienne croissante dans le pays – et en particulier par le pouvoir grandissant du salafisme et du wahhabisme (considérés comme des doctrines religieuses saoudiennes importées).
Mais le point de basculement pour le mouvement houthi a probablement été l’invasion américaine de l’Irak en 2003. Influencés par le succès des combattants du Hezbollah basés au Liban qui ont affronté avec succès les forces occidentales en Irak, les Houthis se sont inspirés et ont obtenu le soutien du groupe basé au Liban, ainsi que de l’Iran – bien que leurs responsables nient ces liens.
2. Comment les Houthis ont-ils pris le pouvoir ?
Pour faire face à la montée en puissance des Houthis, Saleh a lancé une campagne militaire en 2003, avec l’aide de l’Arabie saoudite. Bien que les forces de Saleh aient réussi à tuer le chef des Houthis, Hussein al-Houthi, en 2004, les Houthis ont souvent infligé des revers à Saleh et à l’armée saoudienne, malgré les milliards de dollars dépensés par cette dernière.
En effet, les Houthis se sont révélés être un adversaire redoutable pour les Saoudiens, osant pénétrer en Arabie saoudite en 2009 et forçant le royaume à déployer son armée pour faire face à la menace croissante.
Depuis que la révolution yéménite a éclaté en 2011, les Houthis se sont battus pour chasser Saleh du pouvoir, avant de s’allier avec lui en 2015. Lorsque cette alliance s’est effondrée, ce sont les Houthis qui ont pris le dessus, le groupe rebelle finissant par assassiner Saleh en décembre 2017.
Les Houthis ont également été une force majeure dans la guerre civile yéménite en cours (qui a commencé en 2014), qui a causé environ 377 000 morts, dont de nombreux civils. Bien que le gouvernement du sud soit reconnu par la communauté internationale, les Houthis se sont emparés d’une grande partie du nord du Yémen depuis qu’ils ont pris d’assaut Sanaa en 2014. Ils contrôlent aussi le port clé de Hudeidah, qui génère jusqu’à 1 milliard de dollars de revenus pour le gouvernement houthi.
3. Quelle est leur influence régionale ?
Aujourd’hui, les Houthis comptent environ 20 000 combattants. Depuis la mort d’al-Houthi, le mouvement est principalement dirigé par son frère, Abdul-Malik al-Houthi, qui a déclaré qu’il n’hésiterait pas à attaquer les États-Unis et leurs alliés.
Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre, les Houthis ont tenté de tirer parti du conflit à travers une démonstration de puissance visant à rehausser leur statut international.
Se proclamant solidaires du peuple palestinien, les Houthis ont lancé une série d’attaques contre des navires commerciaux en mer Rouge, dont le Yémen est riverain. L’attaque la plus effrontée a eu lieu le 19 novembre 2023, lorsque des combattants ont utilisé un hélicoptère pour enlever l’équipage d’un transporteur de voitures lié à un homme d’affaires israélien.
4. Contrôlent-ils l’accès à la mer Rouge ?
Bien que la plupart des attaques des Houthis sur la mer Rouge n’aient pas été couronnées de succès, elles ont forcé des milliers de navires à contourner cette route et à se diriger vers l’Afrique du Sud, ce qui a entraîné des coûts et des délais considérables pour le transport maritime.
En représailles aux dizaines d’attaques menées en mer Rouge, les États-Unis et le Royaume-Uni ont répondu par leur plus grande attaque contre les Houthis depuis 2016, quand les États-Unis avaient frappé trois sites de missiles des Houthis après que les Houthis aient tiré sur des navires de guerre américains et des navires commerciaux. Cela avait mis un terme temporaire aux attaques des Houthis. Mais aujourd’hui, alors que les Houthis sont convaincus d’avoir remporté la victoire contre les Saoudiens et l’Occident au Yémen, les rebelles semblent plus désireux que jamais de s’attaquer de front aux États-Unis.![]()
Natasha Lindstaedt, Professor, Department of Government, University of Essex
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
À lire aussi