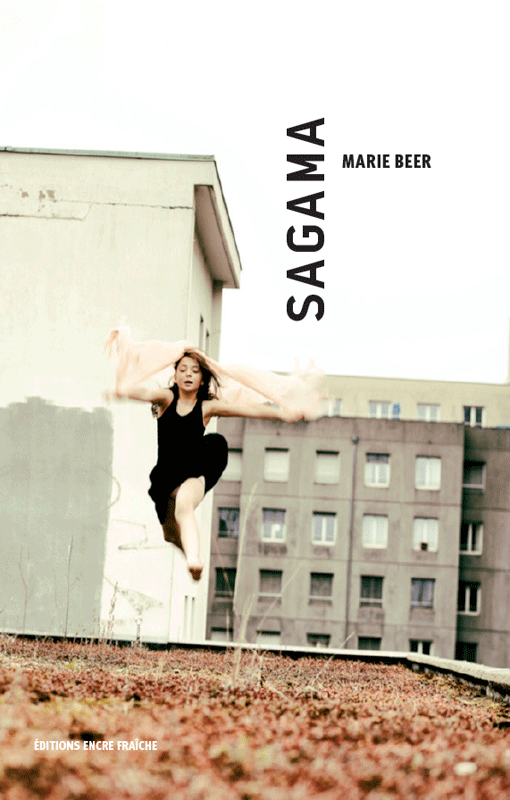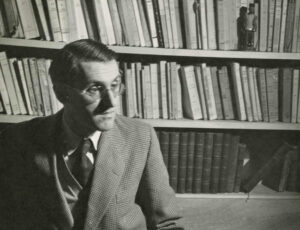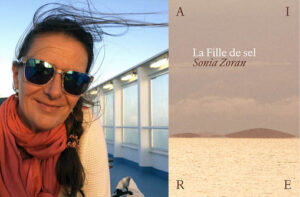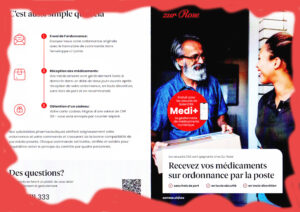Les dérapages de la psychiatrie

© DR
BPLT: Quel a été le point de départ de votre roman?
Marie Beer: J’observe qu’on vit dans un monde rationalisé, où la science fait foi et où les poseurs de diagnostic pourraient eux-mêmes faire l’objet de diagnostic. Présentées comme fiables, ils ont aussi leurs limites et leurs failles qu’ils amènent dans l’institution.
Votre texte a également été adapté pour la scène. Comment passe-t-on du roman au théâtre?
J’ai commencé par écrire le journal intime d’un psychiatre dans l’idée d’en faire une pièce avec Christian Grégori dans le rôle principal. C’est devenu un roman. Pour l’adapter à la scène, il a fallu faire des coupes et redistribuer le texte entre trois comédiens.
Comment vous êtes-vous appropriée tout ce jargon psychiatrique? Quelles ont été vos sources ou œuvres de référence?
Pour une littéraire, étonnamment, j’aime beaucoup les ouvrages scientifiques et, en particulier, ceux qui traitent de psychiatrie. Je me suis documentée au sujet des troubles attribués au personnage de Sagama, à savoir la schizophrénie ou une bipolarité d’aspect atypique.
La forme narrative du journal intime vous impose de garder le même point de vue tout au long du roman. Etait-ce un avantage ou une difficulté supplémentaire pour faire apparaître la mauvaise foi et le déni du personnage principal?
Dans un premier temps, j’avais l’intention d’alterner le point de vue du psy et celui de sa patiente. Finalement, j’ai trouvé plus fort que Sagama (la patiente) et Monique (l’épouse) arrivent à s’exprimer avec force à travers ses observations à lui.
Comment qualifieriez-vous le lien qui se noue entre le psychiatre et sa patiente?
D’ambigu, je pense qu’une double dépendance s’installe et qu’elle n’est pas contenue par le psy qui pense pourtant tout maîtriser.
Est-il normal qu’une patiente puisse appeler son psy en dehors des heures de consultation et si oui, comment éviter que ça tourne en harcèlement?
C’est possible dans certaines situations où le psy estime que son patient peut se mettre en danger. J’ignore comment il pose les limites.
De quels garde-fous dispose (en principe et en l’occurrence) le psy pour rester adéquat dans la relation?
En premier lieu, il est censé être en interaction avec un superviseur, surtout s’il estime perdre le contrôle. Mais pour ça, il faut déjà qu’il reconnaisse ses propres limites. Le problème ne concerne d’ailleurs pas que les psys. Tous des professionnels du social risquent de s’octroyer un pouvoir par les blessures des personnes qu’ils accompagnent. Les égos entrent en jeu, ainsi que le besoin de reconnaissance. Concernant Sagama, mon narrateur est le premier à poser le bon diagnostic
Ce qui exaspère le plus le psychiatre dans ce roman: «ses propres travers projetés chez les autres»
A quel moment s’amorce le dérapage?
Au théâtre, le moment était clairement marqué par un rapprochement physique induit par le comportement de Sagama. Dans le roman, il est amené de façon plus progressive. Le renversement se fait quand le psy apprend qu’il y a eu un abus que sa patiente n’a jamais évoqué.
La fugue est un appel au secours. Y a-t-il d’autres formes de communication non verbale de la part de la patiente?
Oui, ne serait-ce que sa manière de bouger, de danser, d’essayer de séduire son psy, parce qu’elle ne connaît pas d’autre façon d’obtenir de l’affection. Les messages vides sont aussi une forme de communication.
L’épouse de votre narrateur substitue elle aussi l’acte à la parole. Elle met par exemple mettre ses beaux bijoux pour rappeler à son mari que c’est leur anniversaire de mariage, boude pour montrer sa déception au lieu de la verbaliser. Est-ce qu’on le fait tous? Est-ce un travers propre aux femmes?
Monique n’a pas l’aisance verbale de son mari, elle part perdante. Dans le couple, la femme espère susciter une réaction en envoyant des signaux non littéraux.
Dans la relation de couple de votre psychiatre, tout n’est que concession, reproche et malentendu. Qu’est-ce qui les unit?
Ce couple est en pleine crise, mais, comme souvent, la crise n’est ressentie que par l’un des deux. Dans le passage qui décrit leur rencontre, on sent chez le psy une réelle affection pour Monique, le désir d’être avec une femme brillante, mais un peu moins que lui, qui dédie sa vie à sa propre reconnaissance.
Vous exploitez les stéréotypes au point de produire un effet comique. Avez-vous voulu amener ainsi un peu de légèreté en alternance avec la gravité des autres thèmes abordés?
Monique vient en contrepoint de Sagama. Je n’ai pas cherché à amener de la légèreté, mais j’avais à cœur de savoir qui était le narrateur dans sa vie privée. C’est lui qui a de l’humour. Les stéréotypes rendent la relation socialement lisible et convenue en face d’une relation inqualifiable.
Votre narrateur juge très sévèrement ses voisins bobos, les autres passagers de la croisière et les artistes chargés de les divertir. Qu’est-ce qui l’exaspère le plus chez l’être humain?
Ses propres travers projetés chez les autres.
Pourquoi porte-t-il un autre regard sur ses patients?
Je le soupçonne d’être un hyper sensible qui, par sa profession, se rend responsable de la souffrance des autres. Au départ, j’ai envie qu’il émane de lui un certain charisme, que son humour et ses diplômes inspirent confiance, le rendent crédible.
Pour conclure quels sont vos projets?
Sagama va être jouée au Théâtre des Amis à Carouge au printemps prochain et j’écris une autre pièce. C’est l’histoire d’une femme qui vient d’avoir un accident. Son conjoint se rend à l’hôpital. Il a appelé son employeur et découvert qu’elle s’est inventé une vie.
«Sagama», Marie Beer, Editions Encre fraîche, 191 pages.
À lire aussi