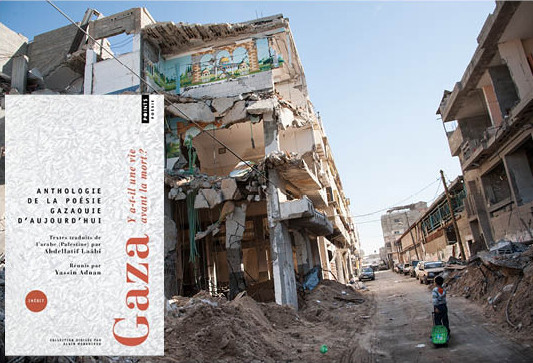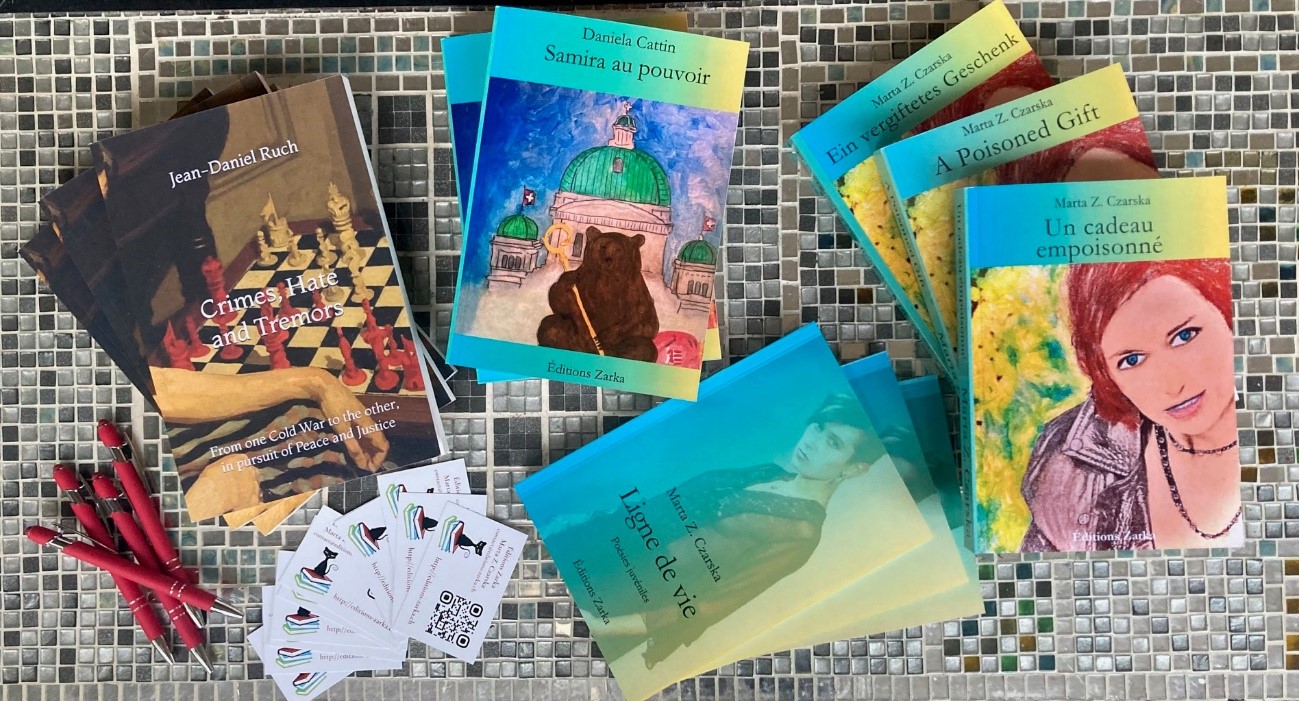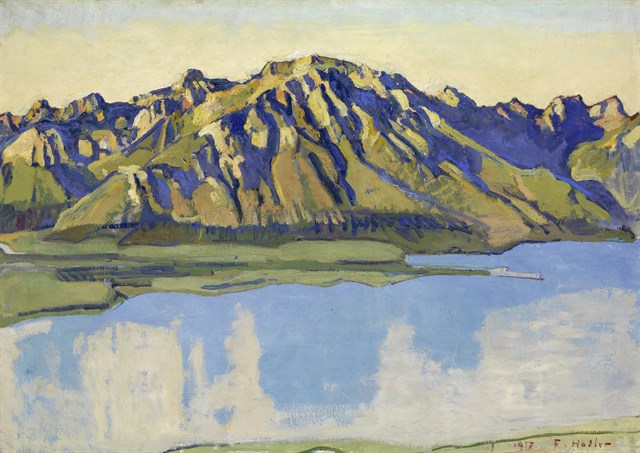La restitution d’une époque où le non-dit était roi

«On ne voulait pas voir Staline dans nos vignes. C’était l’antagonisme ville-campagne.» – © PxHere

Janine Massard. © Sabine Dormond
Gisèle n’a que dix-sept ans lorsqu’elle se fait violer lors d’un bal de campagne. Le petit bâtard qui pousse dans son ventre n’a ni place, ni avenir dans une microsociété rurale où la peur du ragot dicte les faits et gestes de chacun. Le père de Gisèle se résout à perdre tout respect de lui-même pour rester respectable aux yeux des autres (en ce temps, l’instituteur est un notable). Cela passe par l’élimination physique de son petit-fils. Et par la préméditation de ce meurtre tout au long de la grossesse de sa fille aînée.
Ce récit narratif ne laisse aucune place au suspens. Ce n’est pas là que réside l’intérêt du roman. Le lecteur comprend d’emblée que le bébé à naître est condamné. Il s’agit pour l’auteure de reconstituer des faits, une époque, une mentalité au plus près de ce qui s’est réellement passé. Mais on devine aussi un enjeu plus personnel, le désir de rendre hommage ou justice à une amie proche affectée toute sa vie par la scène d’horreur dont elle a été témoin.
Cette amie présentée sous le prénom de Floriane n’est autre que la sœur cadette de Gisèle. Elle n’a que dix ans lorsque sa sœur accouche à domicile dans la plus grande clandestinité. Réveillée par des bruits, elle se cache sous le piano et assiste à la scène sans rien y comprendre, d’autant plus qu’elle ignorait...
Ce contenu est réservé aux abonnés
En vous abonnant, vous soutenez un média indépendant, sans publicité ni sponsor, qui refuse les récits simplistes et les oppositions binaires.
Vous accédez à du contenu exclusif :
-
Articles hebdomadaires pour décrypter l’actualité autrement
-
Masterclass approfondies avec des intervenants de haut niveau
-
Conférences en ligne thématiques, en direct ou en replay
-
Séances de questions-réponses avec les invités de nos entretiens
- Et bien plus encore…
Déjà abonné ? Se connecter
À lire aussi