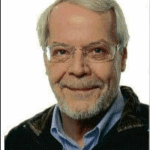Le clochard littéraire de la ligne 9
Ce matin-là, à l’arrêt «Marronnier», monte un hurluberlu sexagénaire sale, mal rasé et mal fringué. Presque pas fringué, à vrai dire, puisqu’il est en t-shirt et espadrilles alors qu’il gèle à pierre fendre. Son pantalon de survêtement noir est en lambeaux et il manque de le perdre à chaque pas. D’une voix de stentor, il dit «Bonjoooour!» à la cantonade, ce qui incite les passagers à se rencogner sur leur siège en regardant fixement ailleurs. Puis il fonce sur moi: «Je vous connais, vous êtes journaliste, vous avez travaillé longtemps en Italie. C’est quoi votre nom déjà?» Je le lui dis, il s’en souvient. Et s’assied à côté de moi. Quelle mémoire! me dis-je.
L’espace de quatre arrêts – disons six minutes – le singulier bonhomme m’explique qu’il adore Andrea Camilleri, qu’il a lu tout Italo Calvino en version originale, qu’il regrette la disparition de Fruttero & Lucentini, ces deux auteurs qui ont écrit tous leurs livres à quatre mains. Puis il passe à la littérature russe, me cite Le pavillon des cancéreux de Soljenitsyne et d’autres œuvres que je n’ai jamais lues. Je saurai encore qu’il a été bibliothécaire à l’Université de Lausanne ainsi qu’au Département des langues et littératures slaves de celle de Genève; que sa grand-mère venait de Domodossola et s’appelait Imperiali.
Juste avant de descendre, il me brandit sous le nez son abonnement de bus. «On dirait que je sors du goulag, hein?», dit-il en désignant la photo. Moi, je déchiffre plutôt son nom: Maurice Trollux. Une énigme. Comment fait-on pour se clochardiser pareillement quand on fréquente la grande littérature? Déjà engagé dans la porte de sortie, Maurice avise une quinquagénaire qui a fait de son mieux pour ne pas le voir ni l’entendre: «Au revoir, Madame, bonne journée!», vocifère-t-il. Elle sursaute, fixe désespérément la pointe de ses chaussures et, lorsque l’olibrius lettré est dehors, pousse enfin un grand soupir de soulagement.
Je me réjouis de revoir Maurice.
À lire aussi