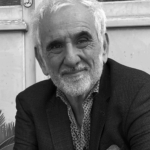La femme des cavernes n’était pas celle que vous croyez

Représentation d’une femme sapiens, âgée de 16 à 18 ans, qui aurait vécu il y a -20 600 ans. Elle fait partie d’un ensemble de trois reconstitutions d’hominidées réalisées entre 2011 et 2013 pour le musée des Confluences de Lyon. – © Musée des Confluences (Lyon, France), photo Olivier Garcin
Si «l’histoire est écrite par les vainqueurs»*, c’est tout aussi vrai pour la préhistoire. L’histoire officielle n’est pas objective, le vainqueur détient le pouvoir de la fabriquer comme il l’entend, pour qu’elle serve et justifie sa domination.
Avec L’homme préhistorique est aussi une femme, c’est à cette construction que la préhistorienne et directrice de recherche au CNRS Marylène Patou-Mathis s’attaque de manière critique. Cette construction qui a durablement manipulé les esprits pour nous persuader que l’homme préhistorique chassait tandis que la femme cueillait et balayait la grotte en attendant, vaguement apeurée, le retour du mâle dominant. Un androcentrisme qui fait que dans l’imaginaire populaire, c’est un homme qui a découvert le feu, taillé les silex, inventé le propulseur, l’arc, chassé les mammouths, conçu le langage. Nous sommes là face à une idéologie, celle du patriarcat, qui se prétend «naturelle» et «génétique» alors qu’elle est purement culturelle et politique. Une idéologie toujours à l’œuvre aujourd’hui: faut-il rappeler que les femmes suisses ne sont devenues des citoyennes à part entière qu’en 1971, et qu’en 2021 l’égalité salariale ne leur est toujours pas acquise, sans parler de leur sous-représentation aux postes de commande?
L’élaboration d’une légende
L’élaboration, au XIXe siècle, de la légende de la condition des femmes à la préhistoire se fonde en partie sur l’idée qu’il s’agit d’une période violente et que seuls les hommes forts pouvaient y faire la loi. Marylène Patou-Mathis explique: «La violence des sociétés préhistoriques du Paléolithique n’étant pas archéologiquement attestées, la relation entre hommes et femmes à cette période n’étaient sans doute pas aussi antagonistes que certaines thèses l’ont avancé». C’est semble-t-il plus tard que les choses se gâtent, pendant le développement du néolithique, lorsque qu’avec l’agriculture arrivent la propriété et l’accumulation de richesses, le patriarcat.
Une des raisons pour lesquelles les femmes devaient rester docilement à la grotte, ne pouvant ainsi pas s’impliquer comme les hommes dans la chasse, la découverte de nouveaux territoires ou les inventions, serait la maternité. Voilà typiquement une inversion de valeur au service de l’idéologie machiste. On peut tout aussi bien imaginer que nos ancêtres préhistoriques, épatés par les femmes qui donnent la vie, les aient considérées comme des êtres magiques à vénérer. Sans aller jusque-là, peut-être que, plus simplement, les femmes et les hommes préhistoriques se répartissaient-ils les tâches et les fonctions selon les réelles capacités individuelles de chacune et de chacun plutôt que hiérarchiquement, dans une logique de domination.
Quand l’ADN prouve que le guerrier était en fait une guerrière
D’ailleurs, le mythe des faibles femmes s’écroule petit à petit, notamment depuis que, grâce à l’ADN, on peut déterminer le genre des ossements retrouvés. C’est ainsi que le guerrier viking de Birka, dont on a découvert le squelette en 1878 en Suède, entouré d’armes, était en fait une guerrière. A l’inverse, la Dame rouge, découverte en 1823 au Pays de Galles par William Buckland et considérée par lui comme une femme par le simple fait de la présence d’un collier, était un homme du Paléolithique supérieur. Les exemples de ce genre se multiplient.
Marylène Patou-Mathis écrit: «Plusieurs travaux paléoanthropologiques montrent que les femmes du paléolithique étaient d’une grande robustesse, même si, en moyenne, elles avaient quelques centimètres et kilos de moins que les hommes. La thèse selon laquelle les femmes étaient moins vigoureuses, car systématiquement privées de nourriture carnée, est réfutée par les analyses de leurs squelettes.»
Aujourd’hui, on est conscient que rien ne prouve que le statut des femmes ait été celui que les archéologues du XIXe siècle ont défini en miroir de celui qui était accordé aux femmes de leur époque.
Des mains de femmes sur les parois des grottes
Ainsi, qui nous dit que les peintures retrouvées dans les cavernes ont été réalisées par des hommes plutôt que par des femmes? «Enracinée au milieu du XIXe siècle, l’idée que les œuvres pariétales auraient été réalisées par des hommes pour des hommes a conduit, là encore, à une vision dualiste de la société préhistorique, écrit Marylène Patou-Mathis. (…) S’il est particulièrement difficile de connaître le sexe des auteurs des œuvres tant pariétales que mobilières, de récents travaux attestent de la venue de femmes dans les grottes ornées. La majorité des 32 mains négatives peintes, il y a environ 25 000 ans, dans huit grottes françaises et espagnoles a été réalisée par des femmes. La même observation a été faite dans la grotte Cosquer (Bouches-du-Rhône), les mains féminines sont plus nombreuses que les mains masculines. Ce constat est d’autant plus important que certains préhistoriens considèrent que les empreintes de petites dimensions retrouvées à côté de certaines œuvres sont des signatures d’artistes.»
Il peut être angoissant pour certains de remettre en question le «ça va de soi» de constructions culturelles données comme «naturelles». Il n’est question, avec L’homme préhistorique est aussi une femme, ni de revendications féministes ni de cancel culture. Il s’agit juste d’une occasion de penser, d’une proposition d’ouvrir le champ des hypothèses et d’intégrer la femme comme acteur de l’histoire et de la préhistoire.
*Citation de Robert Brasillach, journaliste et écrivain français, fusillé en 1945 pour collaboration avec les Allemands.
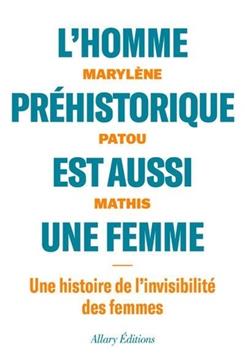
L’homme préhistorique est aussi une femme, Marylène Patou-Mathis, Editions Allary, 352 pages.
À lire aussi