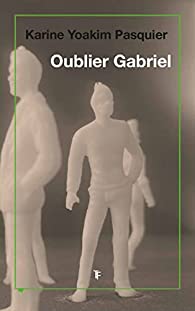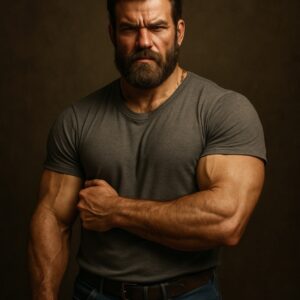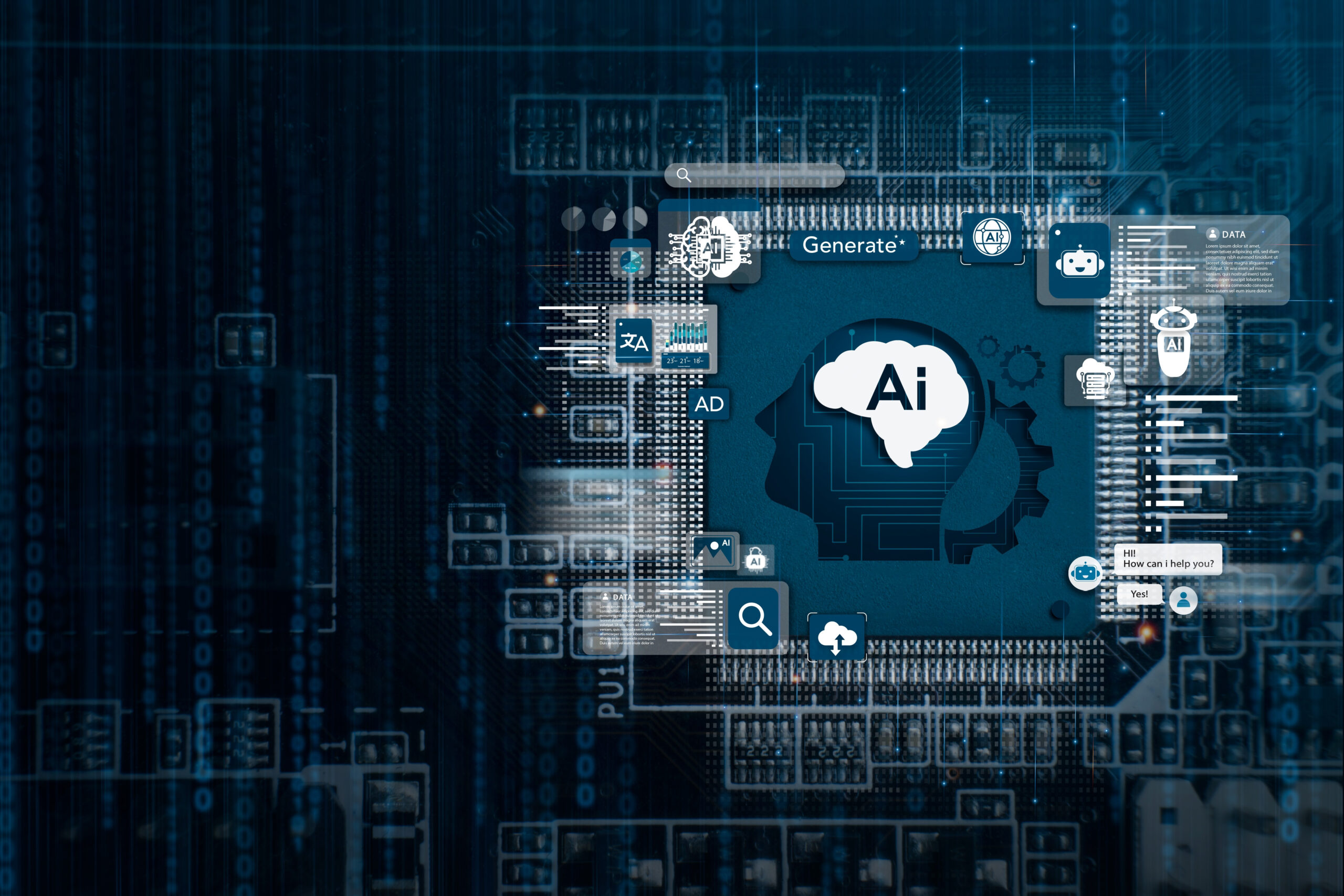Les amalgames, effets collatéraux du 11 septembre 2001

© bruno costa via Unsplash
Oublier Gabriel, c’est l’histoire d’une femme en couple avec un homme qui ne sait rien d’elle, ni de son passé. L’héroïne a tiré un trait sur toutes les années vécues en Suisse et trouvé une certaine stabilité à Milan. Du moins jusqu’au jour où elle reçoit une invitation au mariage de sa meilleure amie de l’époque. Au fil des pages, on croit deviner. Sous la jeune femme affranchie de ses démons émerge une adolescente victime de harcèlement et forcément atteinte dans son estime de soi qui se torture à aimer un garçon aux attitudes ambiguës. Mais ce n’est là que la pointe de l’iceberg.
Sabine Dormond: Votre roman met en scène les amours adolescentes et une jeune fille en proie aux affres de l’incertitude face aux ambiguïtés du garçon qui lui plaît. A l’époque des revendications égalitaires, est-ce encore et toujours au garçon de prendre l’initiative dans les relations amoureuses?
Karine Yoakim Pasquier: Non heureusement, la nouvelle génération a pu se réapproprier des codes sociaux qui sont en train de changer. Dans certaines cultures comme au Canada, ce sont les jeunes filles qui font les premiers pas. A travers Louise, j’ai plus voulu transmettre cette grande angoisse propre aux adolescents, ce manque de confiance en soi et c’est ce qui explique son attentisme. Elle ne sait pas comment décrypter Gabriel. Son attitude aurait été la même si elle avait été un garçon.
Les amitiés adolescentes sont faites de toujours et de promesses rarement tenues à l’âge adulte. Avez-vous une ou plusieurs amitiés qui ont traversé les âges? Que faut-il pour cela?
J’en ai beaucoup, j’ai notamment gardé le contact avec deux amies rencontrées à l’école primaire ou secondaire. La plus grande difficulté, c’est l’éloignement. Ce qui m’a toujours permis de rester en lien, c’est une passion commune pour l’impro théâtrale.
Au début de votre roman, on voit Louise, votre héroïne, victime de harcèlement scolaire et on imagine que c’est cette pénible expérience qui l’a incitée à tirer un trait sur son passé. Mais le roman part ensuite dans une tout autre direction au point qu’on oublie presque cet aspect de la problématique de Louise. Avez-vous changé de thème ou de priorité en cours d’écriture ou était-ce une intention délibérée d’envoyer le lecteur sur une fausse piste?
Quand j’ai créé mes personnages, j’ai réfléchi à tout ce qu’ils avaient traversé et ce vécu de harcèlement faisait partie de la personnalité de Louise. Il contribue à l’intensité des relations avec son groupe d’amis du gymnase, amplifie l’importance de ces liens.
De même, l’histoire est d’abord narrée à la première personne, puis on passe très vite à la troisième. Quelle intention se cache derrière ce changement de point de vue narratif?
J’ai commencé par écrire à la première personne. Vers les deux tiers du livre, je me suis aperçue que je n’arrivais pas à prendre le recul nécessaire pour me plonger dans la tête de Gabriel. C’était mon premier roman, j’apprenais. La narration en je m’empêchait de naviguer entre les points de vue narratifs, c’est devenu un handicap. J’adore les romans à la première personne, mais c’est plus compliqué de prendre de la hauteur et de basculer d’un personnage à l’autre. La troisième m’a aussi permis d’alléger le ton. Mais j’ai voulu laisser une trace de cette première version.
Louise est en couple avec un homme qui ignore tout d’elle et de son passé. Un tel manque de curiosité ou d’intérêt pour l’autre vous semble-t-il possible?
Oui, je crois, même si c’est étrange et peu souhaitable. Je voulais soulever la question de savoir à quel point on peut cacher des pans entiers de sa vie.
Gabriel a été pendant longtemps au cœur de la vie et des pensées de Louise. Peut-elle l’oublier sans oublier aussi toute une part d’elle-même?
Non justement, c’est ce que j’ai illustré par la fuite, elle ne veut plus vivre en Suisse ni parler français. Dans notre région si petite, tout nous ramène au passé. Je me suis demandée si on peut faire table rase ou si on traîne toujours ses casseroles. La fuite m’apparaît comme un leurre.
En quoi l’actualité impacte-t-elle l’histoire de vos personnages?
J’ai ancré le roman au début des années 2000. A cette époque, j’avais l’âge de mes personnages adolescents. Je me souviens du 11 septembre comme du premier événement historique marquant. Chaque génération a le sien, un premier fait d’actualité qui nous touche. La preuve qu’on n’est plus un enfant, qu’on s’ouvre au monde extérieur.
Quels effets collatéraux le 11 septembre a-t-il eu sur nos vies en terres vaudoises?
Sur un plan anecdotique, ça a changé le monde de l’aviation: avant on pouvait aller dans le cockpit, la sécurité dans les aéroports a augmenté, le mot terroriste est entré dans le langage courant. Cet événement a aussi transformé l’image qu’on avait du Moyen-Orient. Ça a dû être un moment compliqué pour les personnes d’origine maghrébine. La chanson 12 septembre 2001 d’Abd al Malik décrit très bien les amalgames qui en ont découlé.
Gabriel subit une agression devant sa copine qui le défend comme elle peut. La manière dont il réagit à l’intervention de Louise m’a paru à la fois inattendue et très plausible. Comment avez-vous réussi à l’imaginer avec autant de justesse?
Je ne me suis jamais fait agresser, mais j’ai discuté avec des gens à qui c’était arrivé et leur ai donné mon texte à relire. J’ai aussi fait des fiches de la vie de Gabriel, j’y ai beaucoup pensé.
Avez-vous été témoin de ce genre d’agression verbale ou physique ou d’autres formes d’expression de racisme ordinaire?
Non jamais d’une agression physique heureusement. Mais de discours comme celui que j’ai retranscris à la page 131:
«Mais Gabriel, tu n’es pas un Afghan toi aussi?»
«Je suis à moitié irakien. Et l’Afghanistan, c’est un pays, pas une religion.»
«Ben… c’est pareil! C’est en Arabie, c’est tout proche. Et les Arabes, c’est des musulmans.»
Est-il facile de trouver ses marques à Hong Kong quand on a grandi aux Avants?
Hong Kong est un paradis de montagnards, un endroit agréable à vivre malgré la situation sanitaire et politique. Mais on me demande toujours d’où je viens, la nationalité prend une place prépondérante. Dans ma rue, je suis tombée sur un garçon qui était mon voisin aux Avants. Il y a une grande communauté francophone et des gens avec qui je peux faire de l’impro.
Votre cadre de vie actuel va-t-il influencer votre prochain roman?
Oui, je suis en train de travailler sur un projet où il est question de Hong Kong, c’est un endroit qui a vécu beaucoup de séismes.
«Oublier Gabriel», Karine Yoakim Pasquier, Editions Torticoli et frères, 348 pages.
À lire aussi