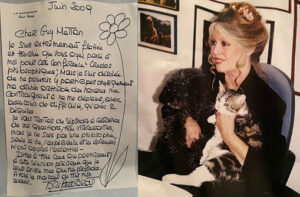De l’espoir à l’espérance

Fresque du château de Parz, Autriche, 1580. – © DR
La température a baissé. L’hiver approche. Ce n’est pas une surprise, car on sait que chaque année l’hiver revient. C’est pourtant toujours une surprise quand nos mains, nos oreilles et notre face redécouvrent le froid qui vient les piquer. Alors on veut s’enfermer chez soi. Alors on tombe dans le coup de blues pour certains. Sans compter que l’approche des fêtes de fin d’année est loin d’être une réjouissance pour beaucoup.
Ces fêtes approchent, et elles nous ramènent à notre solitude. Elles nous ramènent à la famille que nous n’avons plus ou à celle que nous n’avons jamais eue. Elles nous ramènent à nos déchirements. Elles nous ramènent à l’enfance blessée. Comme chaque année, d’aucuns se diront qu’ils se fichent bien de ces fêtes, mais la souffrance demeure…
C’est dans ce contexte, dans ce froid qui s’installe, dans cet Avent angoissant pour beaucoup, dans ces guerres qui n’en finissent pas, dans ces pénuries qui elles ne manquent pas, dans ces burn-out qui se multiplient, dans ces violences extérieures et intérieures qu’un appel à embrasser l’espérance est nécessaire.
Synonymes?
L’espérance est-elle l’espoir? Oui et non. Souvent les deux mots sont utilisés comme synonymes. Il n’y a pas de mal à cela, tant que la réalité d’un mot n’est pas sacrifiée au profit de celle de l’autre. Il y a d’ailleurs des langues où la distinction entre espérance et espoir n’existe pas. Ce qui n’empêche pas deux significations de cohabiter dans un seul et même mot.
En français, nous avons la chance d’avoir deux mots. Profitons-en! Profitons de la nuance que la langue nous offre. Profitons de regarder avec intelligence et profondeur d’esprit les réalités qui se cachent derrière mot et l’autre.
Espoir
L’espoir est un sentiment. Comme l’enseigne le philosophe Thomas d’Aquin, interprétant Aristote, l’espoir est l’une des onze passions – passion, en tant qu’affect ou sentiment – de l’âme humaine. Sans entrer dans les détails, le philosophe nous présente onze passions qui s’imposent à nous en fonction de la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Nous sommes soit face à un bien ou un mal, donc une chose que nous considérons bonne ou mauvaise pour nous. Ce bien ou ce mal sont soit présents face à nous, soit futurs soit obtenus par nous. Aussi, ce bien et ce mal sont soit faciles soit difficiles à être atteints ou évités. Ainsi, le philosophe nous dit que lorsque nous sommes face à un bien futur, et qu’il est atteignable même au prix de nombreux efforts, le sentiment qui s’impose est celui de l’espoir. Comme face à un mal évitable, c’est l’audace qui vient. Ou encore, face à un bien inatteignable, il y a le désespoir. Ou face à un mal inévitable, il y a la crainte.
L’espoir est donc une passion qui s’impose à nous en fonction de la situation que nous vivons. Si l’espoir est une passion, cela signifie par l’étymologie qu’on la pâtit, donc qu’on la subit. On ne choisit pas un sentiment. On ne choisit pas de tomber amoureux, on peut choisir en revanche ce que l’on veut faire de ce sentiment.
On peut avoir l’espoir de manger une bonne gaufre chaude après le travail dans le froid, comme le chien a l’espoir de partir en promenade quand il entend le maître qui prend la laisse. En tant que passion, il n’est ni bon ni mauvais d’avoir de l’espoir, c’est simplement un état affectif qui s’impose à nous. C’est en somme une réaction naturelle de notre être et des autres animaux.
Espérance
L’espérance n’est quant à elle pas un état affectif, elle est un état spirituel. Par spirituel, n’entendez pas religieux, mais comme faisant partie de la vie de l’esprit. Toujours selon le philosophe Thomas d’Aquin, l’esprit est propre à l’être humain et compte deux facultés: l’intelligence et la volonté. L’intelligence est la capacité qu’a l’homme de reconnaître un bien véritable, même si ses sentiments lui disent le contraire. Par exemple, tel médicament pourra susciter le dégoût, et pourtant je sais que c’est un bien pour moi car il me permet de guérir. La volonté, c’est la capacité de choisir librement d’atteindre ce bien véritable.
Etant spirituelle, l’espérance ne dépend pas directement des sentiments, mais de l’intelligence et de la volonté. C’est dans la mesure où un bien réel a été reconnu par notre intelligence, que notre volonté peut choisir de l’atteindre et de mettre en œuvre les moyens pour le faire. Ces moyens pour atteindre un bien s’appellent les vertus. Le courage est une vertu, la patience en est une autre, et l’espérance aussi. La vertu permet d’atteindre un bien, dont l’ultime est le bonheur. Les vertus sont donc au service du bonheur.
En tant que vertu, l’espérance ne s’impose pas à nous. Mais il faut la choisir. Nous subissons l’espoir, mais nous choisissons l’espérance. L’espérance est un état, en quelque sorte un style de vie, que nous adoptons pour notre vie. Elle ne dépend pas des misères ou des joies qui nous arrivent. Elle est un gouvernail que nous tenons ferme dans la tempête comme dans l’accalmie. Ainsi, même si notre sentiment est dans le désespoir, nous pouvons décider de rester dans l’espérance.
Et qu’est-ce que l’espérance? C’est la confiance certaine de goûter à un bien futur. L’espoir peut être déçu, mais pas l’espérance car elle mise toute sa vie dans l’obtention de ce bien, et c’est comme si désirer ce bien, c’était déjà l’avoir obtenu. A la base, l’espérance est une vertu qui vient de la théologie. Avec la charité et la foi, l’espérance est une des trois vertus dites théologales. Dans le christianisme, l’espérance est la vertu qui permet aux croyants de désirer la vie éternelle dans le Royaume des Cieux, et par la confiance – synonyme de foi – en celui qui leur a promis ce paradis, ils savourent ce bien comme s’ils l’avaient déjà obtenu.
De l’espoir à l’espérance
On voit bien en les distinguant que derrière chacun des deux mots se cache une réalité différente. L’une ne doit pas prendre le pas sur l’autre. Il est normal d’avoir de l’espoir qui s’impose à nous, et il est bon d’adopter l’espérance comme choix de vie.
Mais en quoi cela est-il vraiment bon? Après tout, pourquoi ne pas nous contenter de vivre à fond nos sentiments, et donc nos espoirs? Il faut les vivre à fond, mais ne pas se limiter à eux. Car les espoirs sont fluctuants et ne donnent pas les clefs pour se relever d’une déception: j’espère gagner à la loterie, mais je gagne pas, alors soit je reste dans l’illusion qu’un jour je vais gagner, soit je m’enferme dans ma frustration. Je suis amoureux de telle personne, j’espère donc sortir avec elle, mais si elle ne veut pas de moi, que faire pour sortir du désespoir?
L’espérance est aussi une guérison. C’est l’espérance qui, après un désespoir engendré par un espoir déçu, permet de relever le regard, de se dire que tout n’est pas fini, et d’embrasser le courage qu’il nous faut pour affronter la vie et se battre, pour trouver la paix dans notre cœur. C’est cette confiance certaine qui se dit que quoiqu’il arrive, d’une manière ou d’une autre, ça ira.
Dans cet hiver et dans cette tristesse ambiante, il est alors nécessaire de ne plus se nourrir que de petits espoirs, mais de choisir l’espérance. Il est nécessaire de ne plus vivre que renfermé dans ses sentiments, mais d’assumer ses sentiments pour les vivre à la lumière de notre esprit, dans l’intelligence et la volonté.
Il est alors grand temps de s’arrêter un instant, de poser le regard sur le réel, le contempler, et de reconnaître et accepter ce qui vraiment bon et juste pour le sens de notre vie. De choisir ensuite de s’y engager, et de prendre pour moyen l’espérance. L’espérance qui nous guide dans un chemin où nous tomberons certainement, mais où nous trouverons toujours la force pour nous relever.
À lire aussi