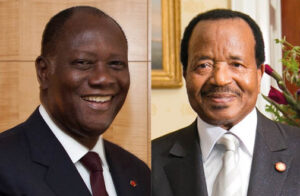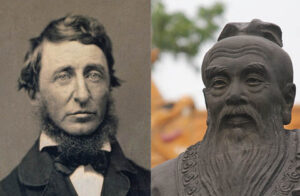Après les élections de mi-mandat, qu’attendre de la présidence Biden?
oe Biden et Kamala Harris lors d’une réunion organisée par le Parti démocrate à Washington le 10 novembre 2022, au surlendemain des midterms. © Samuel Corum/Getty Images via AFP
Marie-Cécile Naves, Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI)
Or, l’électorat s’est fortement mobilisé : on serait aux alentours de 48 %, soit un peu en dessous des 51,8 % de participation aux midterms de 2018, ce qui était très élevé pour ce type de scrutin – rappelons qu’aux États-Unis le taux de participation est calculé par rapport au nombre de personnes ayant le droit de vote et non par rapport au nombre d’inscrits sur les listes électorales.
Le deuxième test portait sur la résistance des Démocrates, et celle-ci fut inattendue : même si, à ce stade, les résultats définitifs ne sont pas encore connus, Joe Biden n’a pas été la victime du vote sanction qu’on lui prédisait.
Fin limier de la politique américaine, il dispose d’une très bonne connaissance des rouages électoraux et des attentes de son électorat. Biden demeure sous-estimé, y compris dans son propre camp. L’inflation n’a pas eu raison de lui et il est probable également que les énormes réformes qu’il a engagées, par la voie législative, en faveur des infrastructures, des emplois verts ou de la relance économique post-Covid, auxquelles il faut ajouter la décision d’annuler en partie la dette étudiante pour plus de quarante millions d’Américains, ont été plus récompensées que prévu.
Une fois encore, la démocratie a résisté aux attaques
À droite, force est de constater que le trumpisme marque le pas.
C’était le troisième test. Il est loin d’avoir disparu puisqu’il persiste sous les traits du plus grand rival de Donald Trump à ce jour, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, triomphalement réélu et tout aussi extrémiste que Trump sur le fond, et puisque des dizaines de « deniers » – ceux et celles qui nient le résultat de la présidentielle de 2020 – ont gagné.
Ils et elles sont cependant beaucoup moins nombreux qu’on le redoutait. Trump ne serait-il donc pas le faiseur de rois (et de reines) que beaucoup pensaient ? Dans les meetings qu’il a tenus aux côtés de candidates et candidats qu’il avait choisi de soutenir – plus en raison de leur flagornerie et leurs excès que pour leur compétence –, il a surtout parlé de lui-même et de son obsession de « l’élection volée » (selon lui) il y a deux ans. Mais gagner une primaire républicaine, où c’est surtout la base la plus fervente qui vote, n’est pas la même affaire que remporter une élection face à une ou un adversaire démocrate. La leçon de l’extrémisme du Tea Party de 2010, qui avait déjà plombé les Républicains deux ans plus tard avec la réélection de Barack Obama, n’a, semble-t-il, pas été retenue, tant le culte de la personnalité de Trump l’a emporté.
Le rejet de Trump et du trumpisme et du danger que l’ancien président fait courir à la démocratie (limitation de l’accès au vote des minorités, refus de certifier des élections si elles sont perdues, etc.) a, ainsi, mobilisé les Démocrates, et notamment les femmes – sans doute aussi les jeunes, à l’échelle nationale.
Depuis l’annulation de l’arrêt Roe vs Wade par la Cour suprême le 24 juin dernier, plusieurs États fédérés (Californie, Kentucky, Vermont, Michigan) ont mis au vote, le 8 novembre, des référendums pour inscrire, ou au contraire supprimer le droit à l’avortement dans la loi ou leur Constitution. Chaque fois, c’est le camp des pro choice qui l’a emporté.
Au-delà des référendums, les sondages de sortie des urnes indiquent que la préservation de ce droit a très largement motivé les Démocrates à voter pour un ou une candidate qui garantirait aux femmes cette liberté. « Les femmes ne sont pas sans pouvoir politique ou électoral », écrivait (ironiquement ?) le juge ultra-conservateur à la Cour suprême Samuel Alito dans l’arrêt « Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization » en juin dernier. Il ne croyait pas si bien dire.
Biden appelle à renforcer le compromis avec les Républicains
Si les Républicains remportent la Chambre (et peut-être aussi le Sénat), leur marge sera bien moindre qu’attendu.
Le président Biden, qui a profité des deux premières années de son mandat pour faire voter une série de grandes réformes, aura toutefois beaucoup plus de difficultés désormais parce qu’il est peu probable que les nouveaux élus républicains – qui prendront leurs fonctions en janvier 2023 – lui facilitent la tâche, à un peu plus d’un an de la prochaine campagne présidentielle.
C’est pourtant bien le sens de l’appel que Biden leur a lancé, le 9 novembre au soir : il estime que le compromis politique est une attente de la société, et a toujours dit faire du combat contre la polarisation politique du pays une priorité. Comme pour conjurer la perspective de deux années de paralysie institutionnelle, voire celle de possibles shutdowns (blocage du fonctionnement de plusieurs administrations fédérales) si jamais le plafond de la dette ne pouvait être relevé en cas de besoin ou si le budget de la nation ne parvenait pas à être voté en 2023 et 2024. En effet, c’est la Chambre des représentants qui donne le « la » sur les dépenses.
Le président devra encore renforcer ses efforts en matière de négociations et de tractations avec l’opposition parlementaire pour poursuivre la mise en œuvre de son programme – non seulement sur le plan socio-économique, mais aussi, et ce sera plus difficile, en matière de protection environnementale. Les Républicains le contraindront, de leur côté, à faire des compromis sur la fiscalité.
Selon le New York Times, il est cependant peu probable que Biden modifie son cap économique : la transition énergétique, qui nécessite de renoncer progressivement aux énergies fossiles, l’effort de réindustrialisation du pays dans la course avec la Chine sur les hautes technologies, la création d’emplois durables, la défense du pouvoir d’achat, la préservation des acquis de l’Obamacare, la lutte contre l’augmentation des prix des médicaments, le combat contre les inégalités sont sur sa feuille de route, surtout dans la perspective d’une possible récession l’an prochain. En revanche, plusieurs grandes lois fédérales promises à l’électorat démocrate pour, notamment, pallier les vides juridiques sur l’immigration, réguler la vente et la circulation d’armes à feu, combattre les discriminations raciales dans l’accès au vote, n’ont aucune chance d’aboutir d’ici fin 2024.
Midterms : le républicain Kevin McCarthy rêve de présider la Chambre des représentants, France 24 9 novembre 2022.
Il est un autre chantier délicat : celui de l’aide militaire à l’Ukraine. Sur le papier, un Congrès républicain en totalité ou en partie, peut s’opposer à de nouvelles dépenses décidées par la Maison Blanche, ou voter des coupes (mais le président possède un droit de véto sur les lois). Dans les faits, le scénario le plus probable à ce stade est que les Républicains exigent davantage de transparence sur l’utilisation des moyens débloqués. Il n’empêche qu’en matière de dépenses militaires en général, la cohérence gagnerait à s’imposer dans les deux partis, démocrate et républicain : avec un budget de plus de 800 milliards de dollars, il est légitime de s’interroger sur le poids que ces dépenses font peser sur le contribuable dans une période inflationniste comme aujourd’hui.
Et 2024 ?
Une fois les derniers résultats des midterms connus (en décembre pour le dernier siège au Sénat, avec le deuxième tour en Géorgie, et cela peut prendre encore quelques jours pour la Chambre), la course sera lancée pour la présidentielle de 2024. Même s’il laisse entendre le contraire, il est peu probable que Joe Biden, qui aura alors alors 82 ans, se représente. Qui, alors, pour lui succéder ?
Plusieurs leaders démocrates émergeront après leur élection ou réélection de la semaine dernière, sans oublier la vice-présidente Kamala Harris, qui devront continuer à composer entre une aile gauche et son électorat impatient (les jeunes en particulier) mais mobilisé donc incontournable, d’une part, et une culture de parti plus modérée d’autre part.
Chez les Républicains, le trumpisme nouvelle formule de Ron DeSantis s’imposera-t-il ou bien la doctrine plus traditionnelle l’emportera-t-elle, par pragmatisme ? À la Chambre, les Républicains mettront, dès janvier 2023, un terme à l’enquête parlementaire sur l’attaque du Capitole, comme si rien ne s’était passé. Mettront-ils leurs menaces à exécution en lançant de nouvelles enquêtes, sur les conditions du retrait de l’Afghanistan, et sur le business du fils de Joe Biden, Hunter ? Cela ne parviendra pas à masquer le fait que, lors de ces midterms, les Républicains ont raté leur coup et que pour espérer l’emporter en 2024, ils doivent également se concentrer sur une question majeure : avec ou sans Trump ?![]()
Marie-Cécile Naves, Docteure en science politique, chercheuse associée au CRI Paris, Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
À lire aussi