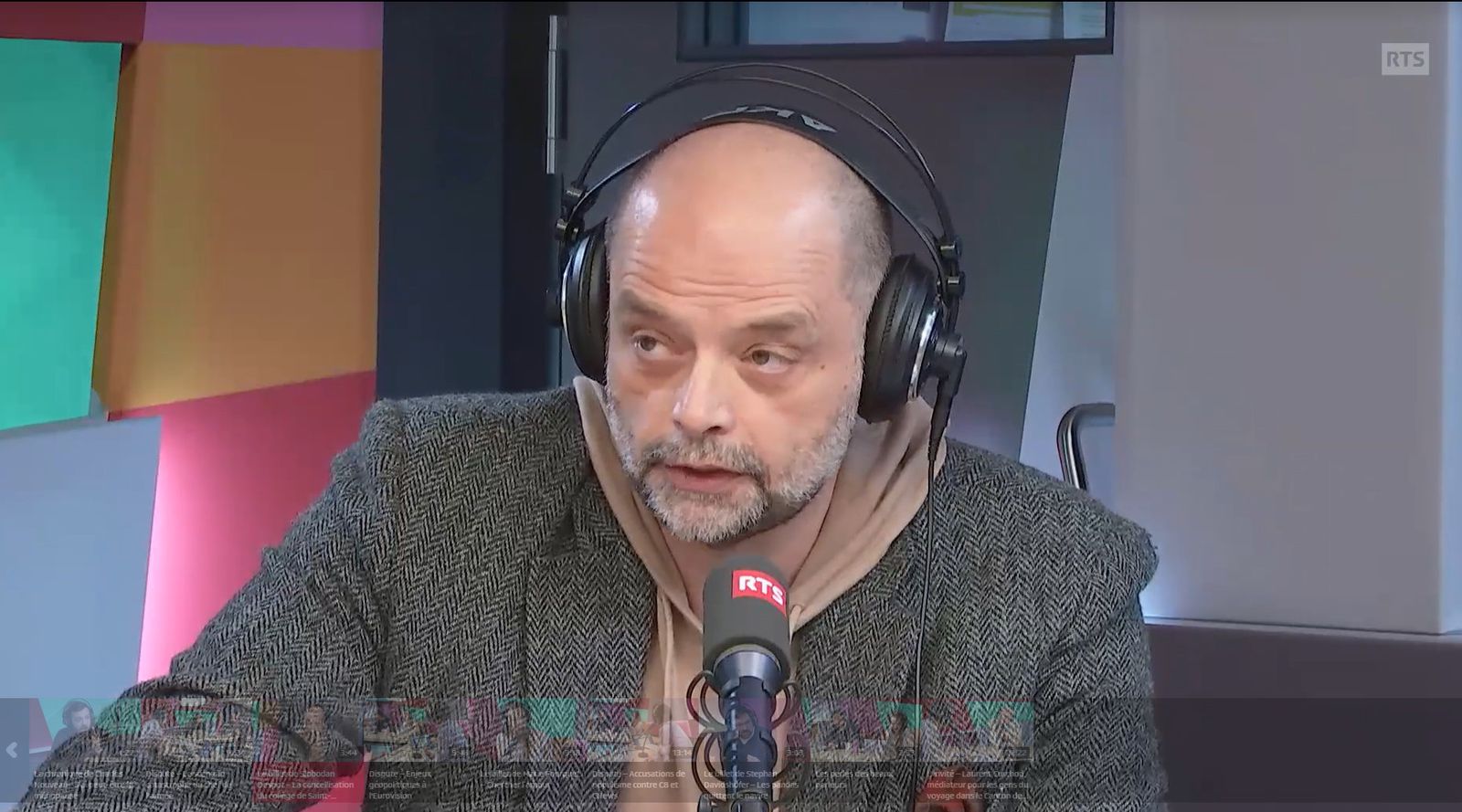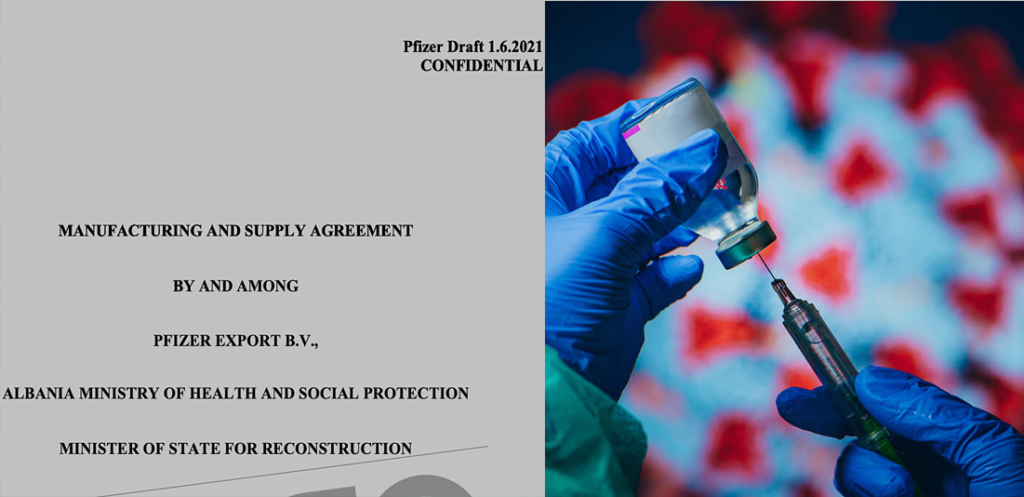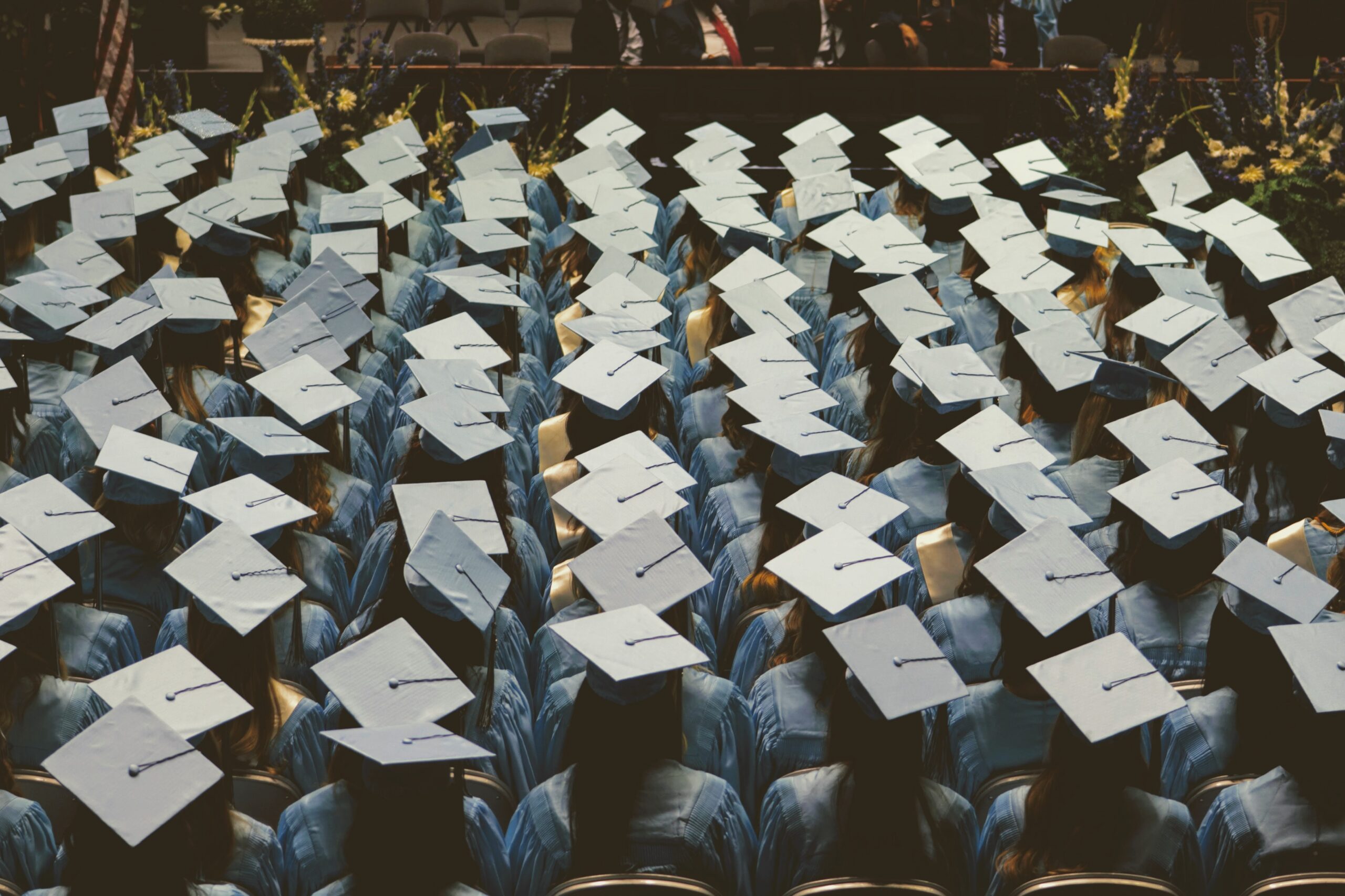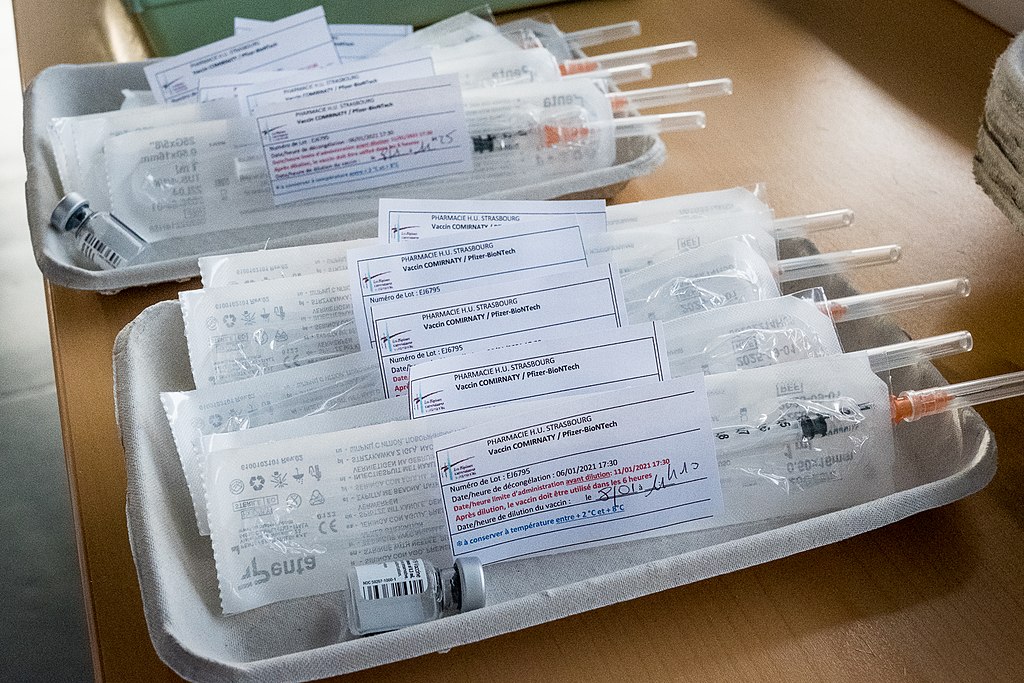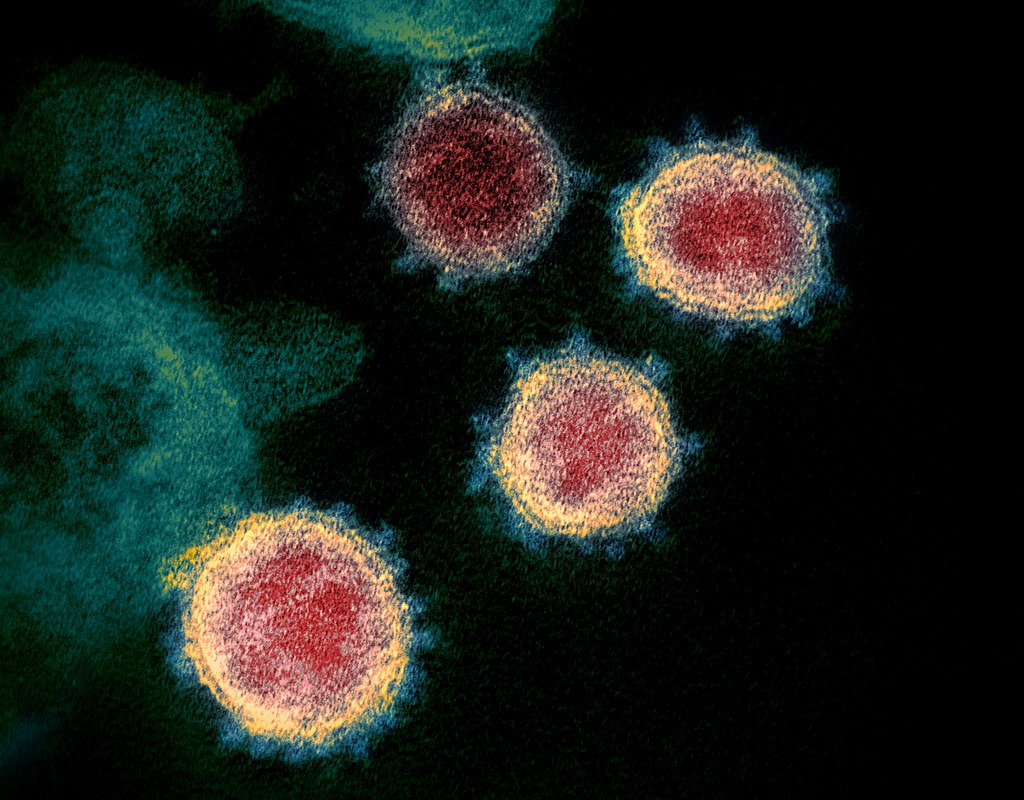Est-il vraiment prudent d’être prudent?
Alors que nous entrevoyons le bout de la 2e vague du covid-19 et la fin de l’année 2020, voici les questions que devront se poser les politiques, main dans la main avec les scientifiques et les médias.
Au regard de l’évolution de la mortalité générale comparée aux autres années, pouvons-nous affirmer avec certitude que le Covid-19 a «mérité» les sacrifices consentis?
Au regard de la comparaison de l’incidence, du taux de remplissage des hôpitaux et de la mortalité entre la Suisse et la Suède, sommes-nous certains qu’une politique activiste (mesures sanitaires) est plus efficace qu’une politique plus passive?
Autrement dit, est-ce que «faire quelque chose» est plus efficace que ne «rien faire»?
Sachant que toute maladie a tant un versant physique que psychosomatique, savons-nous quelle part du remplissage des hôpitaux est due à l’aspect clinique psychologique induit par le climat nerveux général?
Et le nombre d’hospitalisations ne devrait-il pas non seulement être vu comme la source de la panique, mais aussi comme son résultat?
Autrement dit: quel aurait été le taux de remplissage des hôpitaux si le Covid-19 avait été «volontairement» ignoré des autorités et des médias?
Sachant qu’un nouveau virus peut succéder à celui-ci, sommes-nous sûrs de vouloir y répondre à nouveau par une «Michael Jacksonisation» de la société? Est-ce bien la vie que nous voulons sachant que ce ne sera pas le dernier risque sanitaire, pas plus qu’il ne fut le premier d’ailleurs?
Ce virus pose la question fondamentale de la gestion du risque au niveau sociétal: est-ce vraiment prudent d’être prudent?
Sommes-nous conscients de tous les coûts sociétaux, sociaux, affectifs, psychiques, économiques, scolaires directs et indirects, de la prudence? Et si oui, sommes-nous prêts à payer tout cela à chaque fois qu’un risque sanitaire, ou autre, pointera le bout de son nez?
Mais ces questions, aussi pertinentes qu’elles paraîtront à certains, ne servent à rien.
Car, à mon avis, le moteur profond de notre réponse à ce virus est la peur. Peur de tomber malade, peur de souffrir, peur de mourir, peur pour soi-même et peur pour ses proches.
Néanmoins, je suis convaincu que cette peur n’est pas une fatalité. Mais je sais aussi que ceux qui la subissent ne peuvent être «raisonnés» par des arguments.
Si j’ai peur des araignées, on aura beau m’assurer que je ne risque rien à en laisser une escalader ma paume, ma peur et mon rejet subsistent. Et si j’ai peur de l’avion, aucune statistique sur la sûreté du trafic aérien ne pourra me faire monter dans un aéroplane.
Et quand on a peur, on crie. Fort.
Les politiciens n’ont pas pu ignorer ces cris de peur, et ont dû (su) réagir. Certains subissent eux-mêmes la peur.
Mais faites vous-même l’expérience et posez la question autour de vous: «as-tu peur du virus?.. et de la mort?»
Vous serez peut-être surpris, les réponses varient considérablement. Certains répondent «oui, énormément», et d’autres «non, pas du tout». Et posez ensuite la question des mesures sanitaires appropriées face au virus. Comme moi, vous constaterez peut-être que la réponse aux deux questions est liée.
Peur de la maladie et de la mort: «il faut renforcer les mesures sanitaires».
Pas peur de la maladie, ni de la mort: «il faut relâcher les mesures sanitaires».
J’ai le sentiment que la peur de la maladie et la peur de la mort conditionnent la réponse politique que les individus préconisent face au virus.
Si le problème central de ce qui nous arrive était la peur plutôt que le virus en soi, un vaccin pourra-t-il nous en délivrer?
Je ne le pense pas, car la peur survivra au Covid-19, et reprendra les commandes à la prochaine crise.
C’est donc certainement la peur qui doit être traitée en priorité.
Mais si des mots et des arguments sont incapables d’enlever la peur des gens, qu’est ce qu’on peut faire? Si la peur semble imbattable par le raisonnement, quel levier utiliser?
Ce pourrait-ce que la bonne approche ne soit pas «psy», mais «spi», c’est-à-dire spirituelle?
A ce stade le récit devient forcément personnel. Tout ce que je peux raconter ici c’est ma propre expérience spirituelle, en relation avec la peur notamment; parce que la spiritualité est du ressort de la croyance et qu’elle doit rester un thème personnel, privé, absolument non politique, sous peine d’être pervertie.
Voici donc très brièvement mon histoire: en 2008, après un voyage en Asie, j’ai choisi Jésus-Christ comme seigneur et sauveur de ma vie. Depuis, je prends tous les jours un moment, entre 5 minutes et 20 minutes parfois plus, pour prier.
Par la prière, je lui ouvre mon cœur pour qu’il y dépose quantité de choses: la foi, la paix, la joie, l’espérance, l’amour et dans un même mouvement qu’il m’enlève mes peurs et mes soucis.
En compagnie de Dieu, je n’ai plus peur, quelles que soient les circonstances, car je sais que ma vie ici et après est entre ses mains.
Marc Bachmann, citoyen ordinaire
À lire aussi