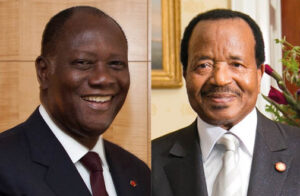Gilets jaunes, gilets rouges, même combat?
Il est très imprudent d’écrire sur un mouvement social toujours en cours, et beaucoup des «analyses» qui ont été livrées jusqu’ici sont devenues, au fil de l’évolution du mouvement, au mieux désuètes, au pire ridicules. Ceux qui prédisaient un échec de la mobilisation du 17 novembre, car soutenue par aucune structure, ont dû rester pantois. Ceux qui prétendaient que ce mouvement n’était qu’une «jacquerie» contre une taxe doivent souffrir de solides insomnies face aux cahiers de revendications qui surgissent des ronds-points. Ceux qui prétendent maintenant que le mouvement s’essouffle devraient se méfier. Le mouvement est peut-être, encore une fois, en transformation. Et je prends le pari que les répercussions de ce mouvement seront aussi surprenantes que nombreuses.
Et c’est sans doute sa première force, comme pour la «Puerta Del Sol» ou pour «nuit debout», ce mouvement s’est affranchi des règles tacites solidement établies quand il s’agit de contester le gouvernement. Et, comme pour les deux mouvements mentionnés, il se démarque par une horizontalité de l’organisation poussée à l’extrême. Il n’y a pas de porte-parole officiel, et ceux et celles qui endossent ce rôle commencent presque tous leurs interventions en rappelant leur illégitimité à parler pour le mouvement. Il n’y a pas non plus d’organe pour représenter et diriger le mouvement et servir d’interlocuteur aux autorités. Dans un pays habitué au centralisme et à l’extrême hiérarchisation, cette non-organisation perturbe les acteurs politiques préexistants.
Face à cet OVNI politique, CGT, CFDT, FO, toutes les centrales syndicales françaises ne savent pas sur quel pied danser. D’autant que ce mouvement a été en premier lieu associé au poujadisme et à l’extrême droite. Et la méfiance est réciproque tant les gilets jaunes répètent qu’ils ne veulent pas être récupérés par les syndicats. Pourtant, même si les militants de l’Action Française ou les royalistes sont présents, ils semblent être une minorité comparés aux syndicalistes, aux anarchistes et aux militants des partis de gauche. Et si, de par sa diversité, il est difficile de coller une étiquette à ce mouvement, la tendance générale qui en sort justifie sa présence. En témoigne le nombre de revendications auxquelles les syndicats peuvent parfaitement adhérer, comme l’augmentation du SMIC ou l’arrêt immédiat des privatisations.
Pourtant, les centrales syndicales semblent désespérément réticentes à soutenir ce mouvement. Il y a sans doute plusieurs facteurs qui expliquent cette frilosité vis-à-vis des gilets jaunes. La non-organisation, par exemple, de ce mouvement est très mal perçue par ces syndicats très centralisés qui ne souhaitent pas engager leur crédibilité sans savoir où va le mouvement et ce qu’il sera demain. Mais les bases militantes de ces syndicats font de plus en plus pression pour que la conjonction des luttes se fasse entre les gilets jaunes et les gilets rouges (portés par les syndicalistes). Et pour contenter ses militants, le patron de la CGT, Philippe Martinez, multiplie les actes timides en direction de ce mouvement. D’autant que certaines branches de la CGT ont déjà décidé de converger lors de manifestation, avec ou sans l’aval de la centrale. Mais, ces actes de Martinez restent définitivement empreints d’une volonté de garder le contrôle de la situation en appliquant la méthode syndicale au mouvement. Des manifestations sont organisées en parallèle ou en décalage de celles des gilets jaunes et son ultime acte de soutien reste un appel à la grève, organisée par la CGT évidement.
Si les centrales syndicales semblent coincées dans leurs méthodes et incapables de se rattacher à ce mouvement social, ce n’est peut-être pas lié qu’à l’organisation centralisée de ces syndicats, mais aussi à la nature même de ceux-ci. En effet, un syndicat est une organisation qui a pour fonction de défendre les intérêts des travailleurs et travailleuses qu’il représente sur le lieu de travail et en politique. De ce fait, il représente des catégories professionnelles précises. Les gilets jaunes est un agrégat de catégories professionnelles très variées qui se réunissent autour de problèmes qui les transcendent. Les syndicats s’inscrivent dans le rapport du salariat et divise donc le monde entre les employeurs et les employés, l’objectif étant d’obliger les employeurs à traiter correctement leurs employés. Les gilets jaunes divisent le monde entre «le peuple» et «l’élite», l’objectif étant de bousculer «l’élite» pour redonner une place au «peuple». Ainsi, de nombreux petits patrons militent aux côtés de chômeuses, de travailleurs sous-payés ou d’employées précaires contre un adversaire qu’ils estiment commun. Finalement, les objectifs que le syndicat poursuit sont matériels et tangibles dans le rapport salarial: augmentations de salaires, garantie de l’emploi, sécurité au travail, etc.. Et si les gilets jaunes portent une partie de ces revendications, ils et elles en portent aussi de nombreuses autres qui dépassent largement le cadre salarial et matériel.
Ainsi, les objectifs conditionnent la manière de fonctionner des uns et des autres. Et comme les objectifs ne sont majoritairement pas les mêmes, bien que certains soient communs, et ne s’inscrivent pas dans le même cadre, les méthodes sont elles aussi différentes. Ainsi, les syndicats, comme organisations, n’ont pas leur place dans les gilets jaunes indépendamment de leur volonté. Mais, ils ont beaucoup à gagner des victoires de ce mouvement. Ils ne peuvent donc pas le rejoindre comme organisation et les centrales syndicales ne peuvent pas être acteurs de ce mouvement. Mais elles pourraient encourager leurs membres et leurs cadres à le rejoindre, à y apporter les connaissances des luttes passées et peut-être y gagner en crédibilité auprès d’une population qui ne croit plus en eux. Mais cette stratégie implique d’accepter de n’être que second couteau dans un mouvement social qui est le premier à réussir là où eux ont échoué.
François Clément, syndicaliste chez UNIA
À lire aussi