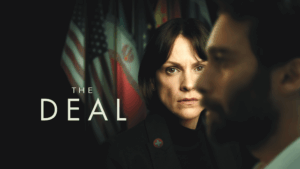Alberto Lattuada, la renaissance d’un grand d’Italie
Pascale Petit et Jean-Paul Belmondo dans «Lettere di une novicia», un film de 1960 d’Alberto Lattuada. – © DR
Quiconque s’intéresse au grand cinéma italien de la période qui va de la Seconde Guerre mondiale aux années 1980 aura forcément rencontré le nom d’Alberto Lattuada (1914-2005), un temps considéré comme l’égal des Rossellini, Visconti, Antonioni, Fellini et Pasolini trônant au sommet du panthéon. Sa réputation n’a toutefois pas survécu à des accusations tenaces de calligraphie, d’éclectisme et d’érotomanie, pas vraiment démenties par une fin de carrière décevante. Un petit maître, alors? Mais dans ce cas, pourquoi cette quantité de monographies qui lui ont été consacrées dans son pays? Il y avait donc un vrai mystère Lattuada, la principale difficulté à réévaluer cette œuvre riche de 33 longs-métrages résidant dans la simple difficulté à voir les films, du fait de la rareté des copies et ceci même en DVD (moins de dix titres édités avec des sous-titres français!).
Arrivant dans la foulée d’une rétrospective à la Cinémathèque française début 2019, celle de Locarno n’est donc pas arrivée trop tôt, même réalisée quelque peu «au rabais» pour cause d’incertitudes liées au Covid: pas de vraie intégrale (manquaient en particulier à l’appel Don Giovanni in Sicilia et la mini-série Christophe Colomb) ni de publication et beaucoup trop de films présentés sans sous-titres. Qu’à cela ne tienne, la démonstration aura été éclatante. Nous avons bien affaire à un auteur majeur, pleinement maître de son œuvre malgré les aléas de production, qui n’a jamais sacrifié aux genres à la mode, à un moraliste soucieux de style autant que d’affronter son époque en libre penseur.
Entre les modes, une manière à lui
A ceux qui déplorent l’absence de chef-d’œuvres canoniques et incontestés, on rétorquera La spaggia (La Pensionnaire, 1954) et Dolci inganni (Les Adolescentes, 1960), deux films extraordinaires qui ont eu maille à partir avec la censure et n’ont dès lors pas été perçus à leur juste valeur. Le premier est une comédie dramatique qui s’en prend avec une virulence rare à l’hypocrisie des valeurs bourgeoises tandis que le second saisit avec une délicatesse exceptionnelle l’éveil à la sexualité et l’entrée dans la vie adulte d’une jeune fille. Malgré leur apparence a priori assez différente (couleur contre noir et blanc, trait caricatural contre réalisme quasi documentaire), la continuité d’inspiration et de style est flagrante: c’est le même esprit qui se place fermement du côté des humbles et humiliés, et ne perçoit de salut que dans un regard sans tabous guidé par le goût de la beauté.
Fils d’un musicien (Felice Lattuada, auteur des partitions de ses premiers films) qui l’obligea à mener d’abord à terme des études d’architecture, Alberto Lattuada possédait des bases solides. Esprit curieux, naturellement antifasciste, grand lecteur devenu tôt critique d’art, photographe amateur et collectionneur de vieux films (avec Luigi Comencini, il est à l’origine de la Cinémathèque de Milan), il débuta comme scénariste et assistant avant de se lancer dans la réalisation, encore durant la guerre. Mais au lieu d’une adaptation des Indifférents d’Alberto Moravia, refusée par la censure, il dut se rabattre sur celle de Giacomo l’idéaliste, un roman du XIXe siècle jugé plus inoffensif. C’est déjà une réussite, mais aussi le début d’un malentendu tenace: rangé parmi les «calligraphes», autrement dit ces cinéastes avant tout soucieux d’une forme soignée, il mit du temps à faire entendre sa voix propre, en réalité aussi présente dans ses nombreuses adaptations littéraires que ses films d’observation sociale plus évidemment personnels.
Après la guerre, il se rapproche du néoréalisme avec Le Bandit et Sans pitié, deux puissants drames qui lorgnent tout autant du côté du «réalisme poétique» français et du «film noir» américain. Mais également avec les merveilleux Les Feux du music-hall (chronique d’une troupe d’artistes de province) et Scuola elementare (un hommage aux petites gens de Milan dont le protagoniste est un instituteur). Quand il adapte avec talent D’Annunzio (Le Crime de Giovanni Episcopo), Baccelli (Le Moulin du Po), Gogol (Le Manteau) ou Verga (La Louve de Calabre), tous des auteurs du siècle passé, le soin formel est encore plus en évidence, faisant dire à un critique que Lattuada est «le meilleur cadreur du cinéma italien.». Il aurait fallu ajouter «le meilleur monteur», car c’est dans l’art du découpage, de mener un récit et d’en dégager du sens, qu’il passe vraiment maître. Ce n’est donc pas un hasard si même un film de pure commande comme le mélodrame Anna devient une vraie réussite artistique et pas seulement un triomphe commercial.
Moraliste, féministe et écologiste
La suite de l’œuvre de Lattuada peut paraître plus erratique, qui flirte avec le grand spectacle (La Tempête, d’après La Fille du Capitaine de Pouchkine), le drame bourgeois (La Novice), le polar (L’Imprévu), la comédie (Mafioso) ou l’espionnage (Fräulein Doktor). En fait, jamais Lattuada ne se fond réellement dans aucun de ces genres. Bien plutôt, il les détourne à son avantage, poursuivant son œuvre de moraliste. De même, cet éclectisme apparent masque son évolution stylistique. Déjà adepte d’une préparation maniaque, il ira toujours plus droit à l’idée. C’est particulièrement frappant dans Fräulein Doktor, évocation romancée d’une fameuse espionne allemande de la Première Guerre mondiale que Lattuada transforme en un théorème pacifiste quasi kubrickien. Rarement la guerre aura paru aussi inhumaine que dans ce film au final inoubliable dans des tranchées «nettoyées» au gaz léthal.
Ses formidables «comédies grotesque» des années 1970 (Venez prendre la café avec nous, Bianco rosso e…/Une bonne planque, Sono stato io/La Grosse tête, Le farò da padre/La bambina, Oh Serafina!) procèdent de la même manière tout en voyant Lattuada dériver vers un anarchisme de plus en plus assumé. Il y renvoie dos à dos communisme et religion, goût des traditions et course au progrès pour rêver plutôt d’une sorte de néo-paganisme écologiste, enfin délivré de ce corrupteur universel qu’est l’argent. Jamais négligé, le sexe y devient de plus en plus central, jusqu’à poser problème quand l’évolution des mœurs autorise à en montrer de plus en plus. Depuis toujours intéressé par le corps comme lieu d’une vérité intime irréductible, Lattuada devient-il dupe de sa réputation de découvreur de nymphettes?
Les féministes adeptes de la théorie du «male gaze» (ce regard masculin qui entacherait toute représentation du corps et du désir féminin) feraient en tous cas bien de se pencher sur son cas. Car s’il y a indéniablement une dérive de Guendalina (chronique sensible d’un premier amour) à Cosi come sei/La Fille (chronique d’un dernier amour démarquant Homo Faber de Max Frisch), le féminisme de ce cinéaste n’en reste pas moins réel. Et il est frappant qu’après avoir inauguré lui-même cette problématique dans Les Italiens se retournent (sketch mémorable du collectif L’amore in città,1953), son tout dernier travail télévisuel, Mano rubata (1989), réponde avec un certain génie (quoique sans art cette fois) à cette même question.
L’indépendance récompensée
Au passage, il n’est pas non plus inutile d’apprendre que Lattuada a mis le pied à l’étrier à trois collègues, Dino Risi, Federico Fellini et Marco Ferreri, dont l’œuvre dialoguera dès lors avec la sienne. Qu’il cosigna le scénario de chacun de ses films mais ne parvint à réaliser que la moitié de ses projets, laissant derrière lui toute une œuvre fantôme. Que par souci d’indépendance, il jongla avec les producteurs et n’employa en général les superstars (Sordi, Tognazzi, Loren, Mastroianni, Giannini, etc.) qu’une seule fois. Et qu’en bon Italien il avait le sens de la famille, restant marié 60 ans à l’actrice Carla Del Poggio, qui joua dans quatre de ses films et dont il eut deux fils (présents à Locarno), faisant régulièrement jouer ses beaux-parents (Ugo et Maria Pia Attanasio) et confiant la direction de production à sa sœur Bianca Lattuada, pionnière dans ce métier.
Après revision de toute son œuvre, on n’y trouve guère que trois films décevants: la parodie d’espionnage Matchless, commande sans intérêt qu’il eut la faiblesse d’accepter, le mélodrame sexuel La Cigale, qui procédait clairement d’un calcul commercial, et son chant du cygne Une épine dans le cœur (1986), belle réflexion sur l’amour gâchée par une interprétation défaillante. «Je n’ai rien à craindre d’une rétrospective, tout à y gagner», aimait-il à déclarer. Ce n’était pas une fanfaronnade. Juste la conscience de sa valeur de la part d’un homme qui avait engagé non seulement son savoir-faire mais aussi son esprit, son cœur et ses tripes dans ses films.
Rétrospective à la Cinémathèque suisse de Lausanne
À lire aussi