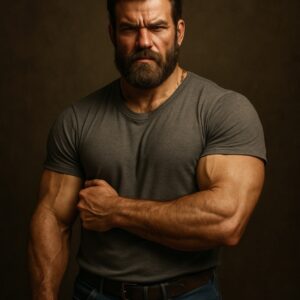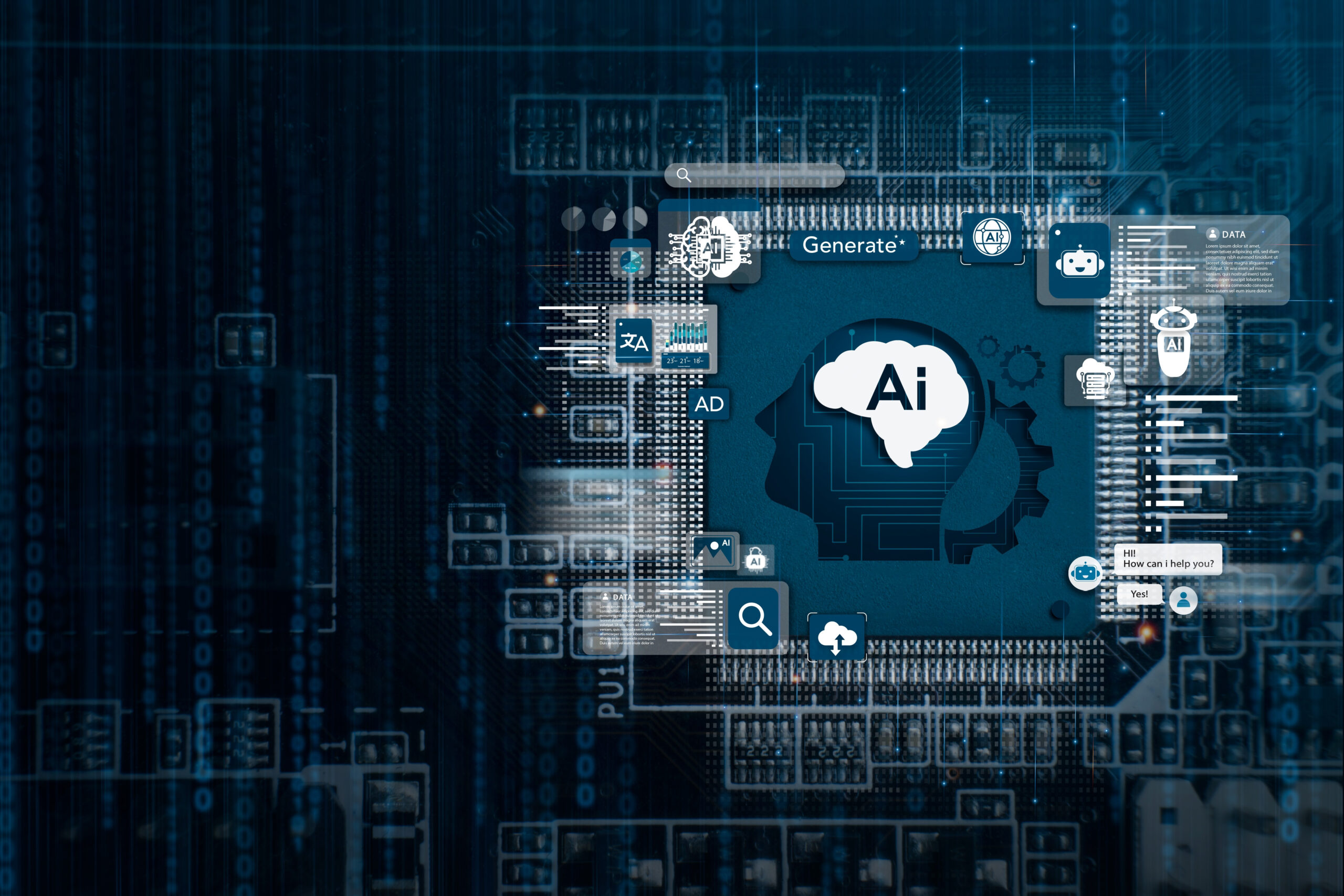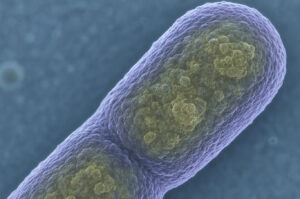Corée du Sud, le pays qui n’aime plus

Un mariage (phénomène de plus en plus rare) en Corée du Sud. – © Rory O’Donnell – CC via Flickr
L’histoire que le journaliste Felix Lill raconte dans la Neue Zürcher Zeitung est celle de Seok Jae Yeon, une jeune sud-coréenne de 30 ans, employée dans un centre d’appels. C’est aussi, sans céder aux sirènes de la généralisation, l’histoire de la plupart de ses compatriotes féminines.
«Le désir des hommes m’a quittée» avoue-t-elle. Seok Jae Yeon est célibataire et a l’intention de le rester. Elle passe, aux yeux de ses collègues et de son patron, pour une «féministe», un qualificatif très négatif en Corée du Sud.
La «guerre des genres» qui sévit depuis quelques temps dans le pays, au taux de fécondité le plus bas du monde (0,98 enfant par femme), a plusieurs causes. Cette expression, accompagnée d’affrontements verbaux (parfois violents) entre hommes et femmes, a émergé sur les réseaux sociaux à l’occasion du mouvement #metoo en 2017. Cela répond à la situation particulière de la Corée du Sud, le pays industrialisé qui discrimine le plus les femmes dans le monde du travail. Un rapport du World Economic Forum sur l’égalité des sexes en matière de travail, d’accès à la santé et à l’éducation et de représentation politique, classe la Corée du Sud 108ème sur 152 pays. Quant à l’inégalité salariale, c’est une réalité parfaitement intégrée et acceptée – jusque là. Selon Young Na, la présidente de Share, une association qui lutte contre les inégalités, les Coréennes gagnent moins que leurs collègues masculins pour une raison simple: une femme n’a pas à être indépendante, elle doit forcément envisager de se marier avec un homme, qui gagne mieux sa vie. Seulement, l’instabilité du marché du travail met de nombreuses femmes dans des situations précaires, et même les hommes avec un revenu stable et confortable sont de plus en plus rares. Un tiers des actifs n’a pas d’emploi permanent.
Bref, résume Young Na, la Corée du Sud est «un pays qui n’aime plus». En chiffres, ce sont seulement 4 jeunes adultes sur 10 qui déclarent avoir une relation amoureuse, 75% des 25-29 ans sont célibataires et plus de la moitié des 30-34 ans.
Mais plus encore qu’en données statistiques, c’est dans le discours et les représentations que se fait jour cette «guerre des sexes». Les jeunes femmes interrogées par Felix Lill rapportent toutes des propos similaires: les hommes n’aiment pas les «femmes confiantes» (comprendre: indépendantes ou souhaitant le devenir, ayant leurs propres opinions et refusant de rester au foyer). Compte tenu de l’âpreté du marché du travail, les femmes tenant des discours féministes sont considérées par ces hommes comme des «incendiaires», semant le désordre dans la société. «S’ils ne veulent pas des femmes d’aujourd’hui, ils resteront célibataires!», répond Seok Jae Yeon.
Et certains joignent l’acte à la parole. En 2017, un homme affirmant «ne pas aimer les femmes» a poignardé une inconnue dans des toilettes publiques. De nombreuses victimes de harcèlement sexuel, d’agressions ou de viols se sont depuis manifestées, parmi elles des sportives de haut niveau, comme la championne de patinage de vitesse Shim Suk Hee.
Contrairement à la plupart des pays dans lesquels le mouvement #metoo a amorcé une esquisse de changement, au moins dans l’écoute de la parole des femmes victimes de violences, la société sud-coréenne campe sur ses antagonismes. L’incapacité, pour les hommes et les femmes d’une même génération, de se comprendre et de cohabiter, a des conséquences démographiques bien réelles. D’ici à 2027, la population est amenée à diminuer.
D’autant plus que Seok Jae Yeon, comme beaucoup de ses compatriotes, n’aspire plus qu’à l’émigration, de préférence vers l’Europe.
Sous nos latitudes, elle espère trouver, grâce à ses diplômes universitaires, un emploi stable et justement rémunéré, mais surtout, une société moins patriarcale, bien plus égalitaire et sûre pour les femmes – et pourquoi pas un mari.
Le virus du patriarcat toucherait donc le monde à des degrés bien divers. Ce que certaines de nos féministes nous dépeignent comme un enfer sexiste et machiste a des airs d’Eldorado vu de l’autre côté de la planète. Est-ce vraiment une surprise?
L’article original, en allemand, est à lire ici.
À lire aussi