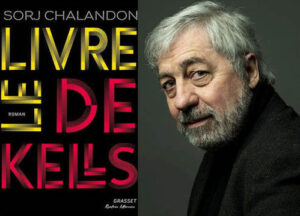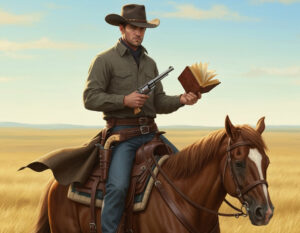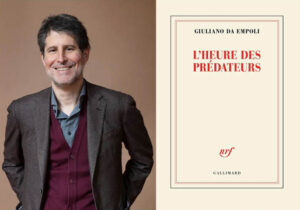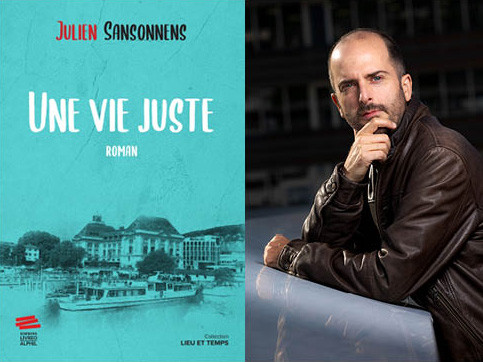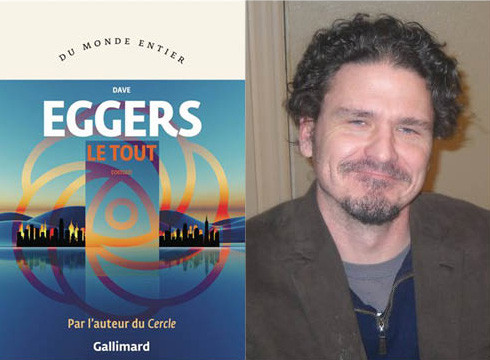Amélie et Zadie pratiquent la même sorte d’humour panique

Zadie Smith et Amélie Nothomb. – © DR
Deux écrivains top. Deux auteurs super. Quelque part: deux poètes. On pourrait dire aussi: deux écrivaines, deux autrices, deux espèces de poétesses-prosatrices. Ou encore: deux écrivisses, deux autorelles qui gèrent un max. Deux meufs qui assurent grave – on peut dire ou écrire ce qu’on veut.
Ou plus exactement: elles écrivent ce qu’elles veulent. Chacune à sa façon: Amélie Nothomb avec sa vieille malice de sale gamine de bonne famille déjantée, et Zadie Smith, plus «métissée» d’extraction et plus académique de formation, en grappilleuse sauvage supérieurement éduquée. La comparaison ne sera raison que si l’on rend à chacune ce qu’elle a d’unique, à la même enseigne d’une littérature vivifiante où l’observation du monde actuel le dispute aux coups de sonde personnels.
S’il fallait résumer les deux derniers livres d’Amélie Nothomb et de Zadie Smith dans le langage pycho-social au goût du jour, l’on pourrait dire que Premier sang représente la «quête du père» de la première, et que les dix-neuf nouvelles du recueil Grand Union de la seconde «travaillent», notamment, les multiples aspects du «relationnel familial», avec un «focus» privilégié sur la relation mère-fille. Langage d’époque, à peu près juste pour le «pitch» mais qui ne dit rien de ce qui fait l’intérêt respectif de ces deux ouvrages, à savoir leur ton, leur étrangeté, leur pénétrante intelligence des réalités humaines, leur indépendance d’esprit, leur mélange de faits très concrets et leur capacité d’abstraction sans pédantisme, leur mordant et leur drôlerie.
Où le «roman familial» devient conte de fées et d’effroi…
Après une trentaine de romans dont certains, comme Stupeur et tremblements, ont un caractère partiellement autobiographique – mais à vrai dire je crois que tous participent de cette transposition –, Amélie Nothomb fait de Patrick Nothomb, son père diplomate et écrivain, le protagoniste de Premier sang, dont le titre évoque la phobie irrépressible de celui-ci, qui s’évanouit dès qu’il voit du sang.
En tant que diplomate, Patrick Nothomb est sorti d’une prise d’otages au Congo ou le sang a coulé, mais pas le sien. En tant qu’écrivain, il a raconté ses expériences variées comme son propre grand-père a raconté les siennes dans une flopée de livres oscillant entre politique nationaliste et poésie plus ou moins assommante. Raconter la saga de la famille Nothomb, célèbre en Belgique bien avant Amélie, demanderait le coffre d’un Balzac. De l’arrière-grand-père ministre à l’oncle bibliste (Paul Nothomb, ancien compagnon de Malraux, est un exégète de l’Ancien testament reconnu jusqu’au Japon où naquit Amélie…), le feuilleton familial des Nothomb semble «romanesque» à souhait, virtuellement saturé de curiosités «pipoles» dont Amélie, à vrai dire, n’a que fiche.
De fait, Premier sang ne raconte que la détresse d’un petit garçon rejeté par sa froide et belle sorcière de mère à visage de fée – qui a l’excuse d’avoir perdu trop tôt son prince charmant –, sa délectable saison en enfer passée chez des oncles-enfants de son âge (la terrifiante tribu Nothomb qu’il adore illico), son aguerrissement dopé par la rage de survivre, son premier amour défiant un grand-père à dégaine d’ogre, et enfin (j’abrège), son salut à la Schéhérazade quand, devenu diplomate (il se voyait d’abord en gardien de but professionnel), il empêche ses bourreaux de le tuer en leur racontant des histoires – littérature quand tu nous tiens! Tout cela en somme ressaisi dans un conte de fées et d’effroi, avec la fulgurante rapidité et le simplisme apparent de tous les livres d’Amélie Nothomb.
La poésie d’un réalisme exacerbé
Un critique a parlé de «réalisme hystérique» à propos des romans de Zadie Smith, et celle-ci a trouvé ça pertinent en dépit de l’apparence désobligeante de la formule, qui pourrait convenir aussi, dans une configuration de la réalité évidemment très différente, aux romans d’Amélie Nothomb; mais je dirais plutôt: réalisme panique.
Ces deux auteures achoppent à la douleur des gens qui a de quoi vous rendre fou. Or, percevoir la douleur des gens avant de l’exprimer sans larmoyer ou prêcher, et l’exorciser avec des mots qui se jouent de la folie est leur job d’écrivain, comme le ferait en blaguant le griot sous l’arbre à paroles ou la rappeuse dépassant la platitude «réaliste» du rap-qui-dénonce.
En dix-neuf nouvelles étincelantes de porosité sensible et de vivacité féroce ou tendre, Grand Union évoque le monde actuel en ses avatars tendre ou féroces, avec une acuité qui, faisant mal, fait du bien parce qu’elle dit vrai.
Quand Amélie semble donner dans la «quête du père» en paraphrasant malicieusement Sacha Guitry («Mon père est un grand enfant que j’ai eu quand j’étais tout petit»), Zadie, dans la dernière nouvelle éponyme de son recueil, évoque la rencontre nocturne d’une femme de même origine (sa mère venant de Jamaïque, comme chacune et chacun sait) et de sa mère ressuscitée le temps de fumer une clope et parlant de leurs ancêtres communs ; et ce thème de la relation mère-fille apparaît déjà dans la première nouvelle, Une dialectique, évoquant l’effort que fait une mère de se raccrocher à la mouvance «animalitaire» actuelle pour se rabibocher avec sa fille adolescente, qui n’en a rien à braire.
Le thème du langage et de ses pouvoirs, explicite ou pas, revient d’ailleurs dans les nouvelles de Zadie Smith, qu’on le «travaille» en atelier d’écriture (elle en est une spécialiste à New York) ou qu’on écoute de vieux punks dans le square d’à côté. Or pendant que foisonnent les «discours sur», l’écrivaine, comme l’ont fait un Tchekhov ou un Raymond Carver, oublie qu’elle est une universitaire ferrée pour s’ensauvager, comme disait l’autre, à l’observation d’une lycéenne de 19 ans trahissant son boyfriend noir qui file la parfaite amitié avec un dealer blanc – épisode qu’elle revit vingt ans plus tard, et tant qu’à pointer la «racisme ordinaire», la voici relater la mort absurde d’un brave type affligé d’un terrible mal de pouce (ça arrive) que poignarde un poète blanc comme l’autre jour un flic blanc a flingué un jeune métis sur le quai d’une petite ville «riante» de la côte lémanique – de quoi nourrir le «discours» antiraciste, mais l’écrivain dit alors autre chose qui procède de l’imaginaire, etc.
Du côté de la vie, sans «discours»….
Amélie Nothomb et Zadie Smith sont, au regard des médias mondiaux, deux «stars de la littérature». Mais pourquoi cela? Pourquoi le plébiscite de tant de lectrices et lecteurs? Par le jeu des artifices: thèmes «porteurs» et autres chapeaux rigolos, genre Harry Potter chez Amélie ou turban de sultan pour Zadie? Je n’en crois rien.
La première fois que j’ai rencontré Amélie Nothomb, après la parution d’Hygiène de l’assassin, son premier roman au succès immédiat, elle traversait la cour intérieure de l’immeuble de son éditeur (Albin Michel, à Paris) avec une pile de plus de cent lettres sur les bras. Depuis lors, des milliers d’autres missives personnes lui ont prouvé que ce qu’elle écrit, n’en déplaise à tant de critiques distraits ou de lettrés pincés, touche à quelque chose de profond en chacune et chacun, comme les contes de Madame Aulnoy, n’est-ce pas… Amélie m’annonça alors qu’elle avait plus de vingt romans à paraître dans ses tiroirs, et bien sûr elle bluffait comme lorsqu’elle prétendait relire Le rouge et le noir chaque année. Et pourtant elle disait vrai «quelque part», comme Zadie Smith dit vrai dans toutes ses exagérations métaphoriques de réaliste «hystérique».
Telles sont les petites filles demeurées, aux cœurs aussi purs que ceux des vieux punks de toutes les couleurs, fées de la sensibilité et sorcières de la forêt des contes que représente la Littérature…
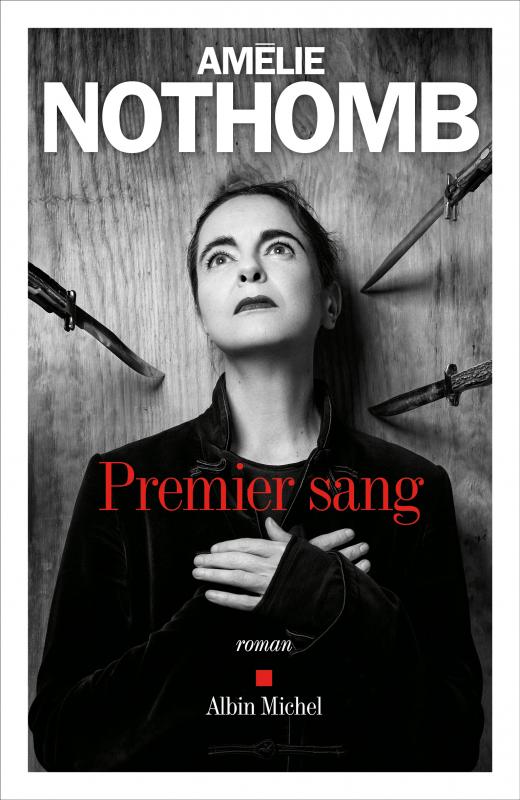
Premier sang, Amélie Nothomb, Editions Albin Michel, 180 pages
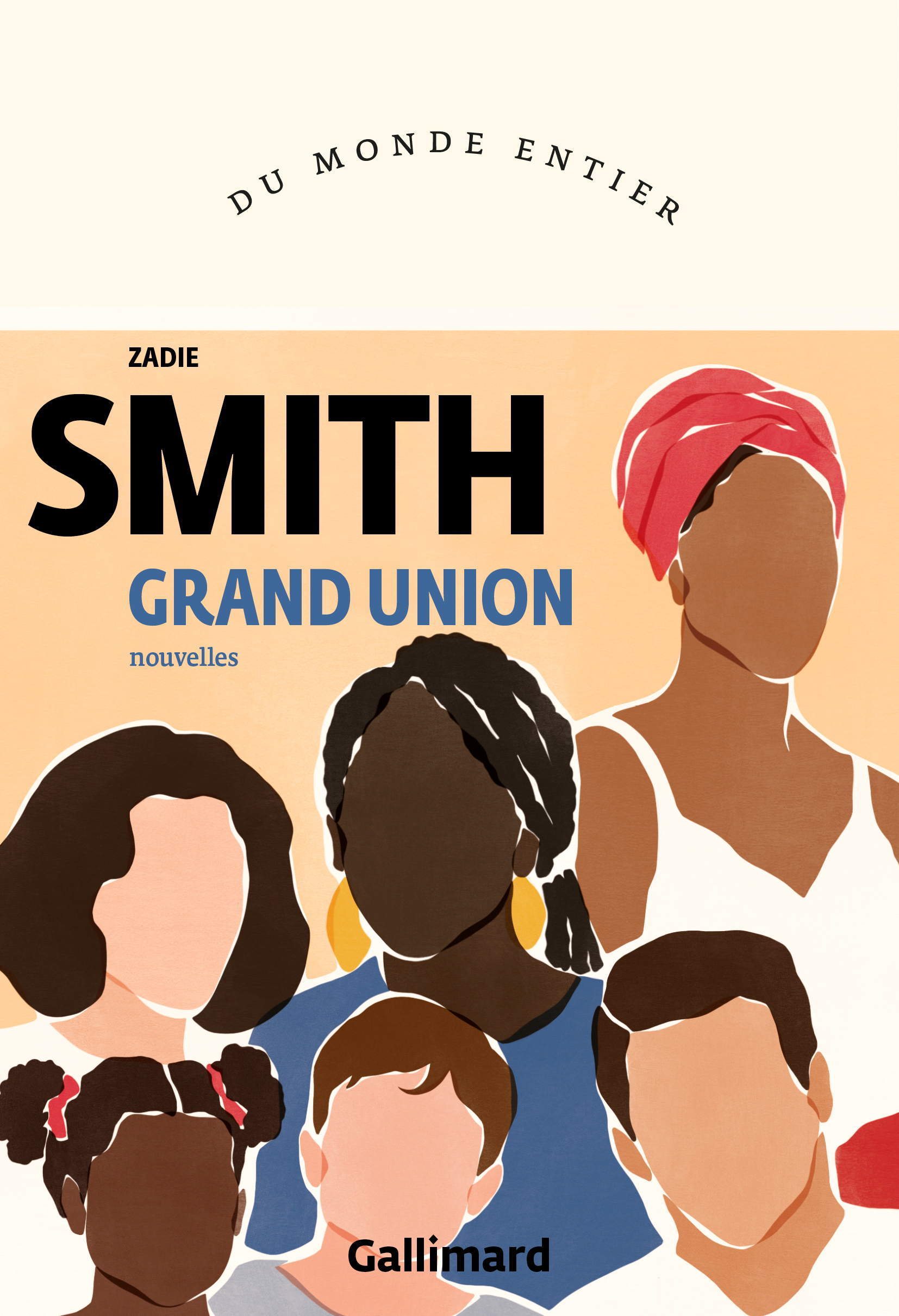
Grand Union, Zadie Smith, Editions Gallimard, 288 pages
À lire aussi